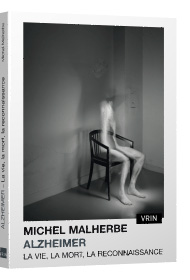Découvrir une bouteille à la mer : le philosophe Michel Malherbe parlant d’Alzheimer
par Bertrand QUENTIN
Agrégé et Docteur en philosophie. Maître de conférences HDR à Paris-Est Marne-la-Vallée Laboratoire LIPHA EA7373
Responsable du Master 1 de Philosophie parcours "éthique médicale et hospitalière appliquée" (Ecole éthique de la Salpêtrière)
Critique de l’ouvrage de Michel Malherbe, Alzheimer. La vie, la mort, la reconnaissance. Une chronique et un essai philosophique, Paris, Vrin, 2015.
Article référencé comme suit :
Quentin, B (2017) "Découvrir une bouteille à la mer : le philosophe Michel Malherbe parlant d’Alzheimer" in Ethique. La vie en question, nov 2017.
NB : L'article se trouve en version PDF au bas du document.
Nous développons dans cet article des points non développés dans l’article que nous avons déjà consacré à cet ouvrage et publié dans le N°68 de la revue Cités (Cités, N°68, déc. 2016, pp.171-184).
Michel Malherbe est philosophe et universitaire, spécialiste d’auteurs du XVIIIe siècle mais Alzheimer. La vie, la mort, la reconnaissance paru chez Vrin en 2015 nous parle de bien autre chose puisqu’il est le compte-rendu de ses observations et de ses réflexions philosophiques sur la maladie d’Alzheimer. Son épouse Annie en fut atteinte à l’âge de soixante ans passés. Depuis lors, dix années de vie et de déclin se sont écoulées qui l’ont menée dans un établissement spécialisé où, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, elle subsiste, nous dit-il, à l’état grabataire ("Gir 1" selon la nomenclature de la dépendance).
L’ouvrage mêle l'autobiographie de ces visites à l'unité Alzheimer á des discussions philosophiques où les grands philosophes sont conviés tour à tour (Aristote, Levinas, Locke, Kant, Scheler etc.). Et cela, dans un va-et-vient avec le portrait cocasse (ou cruel) de ces différents résidents aux maladies neurodégénératives. Il dialogue avec un interlocuteur qui es censé être plein de bienveillance et d'optimisme "levinassien" et Malherbe nous fait sentir à chaque fois que pour lui ce discours "ne tient pas". Car l’Auteur nous dit assister à une "dénaturalisation ontologique" (225) de sa femme.
L’interlocuteur fictionnel lui parle d’elle et lui demande : "est-ce que vous la reconnaissez comme celle qu’elle a été et que vous avez connue ?" Je réponds : "Oui, sans doute, mais cette question évidente en cache une autre qui l’est beaucoup moins : est-ce que je la reconnais, elle, non pas telle qu’elle a été mais telle qu’elle est à présent, est-ce que je la reconnais dans son humanité ?" (89). "Je n’ai pas de peine à identifier Annie : je sais qu’elle est comme à l’accoutumée près de la fenêtre, elle a même apparence, elle conserve certaines attitudes qui lui sont familières ; bref, j’en sais assez d’elle pour l’identifier sur le champ. Et néanmoins je me demande si je la reconnais, car la maladie l’a proprement rendue méconnaissable. Et je dis : "Non, ce n’est pas elle, c’est maintenant quelqu’un d’autre" ou pire, tant ma frustration est grande : "elle n’est plus là, il n’y a personne"" (183-184). "Voilà l’objet de mon discours : comment reconnaît-on un être humain ?" (9).
Voilà donc le drame vécu par l’Auteur dans toute son acuité, drame qui n’est pas une élucubration philosophique. Michel Malherbe doute de l’humanité de sa femme. "Un échec de communication traduit un déficit d’expression, et ce déficit traduit un appauvrissement d’être. Une telle conclusion est assurément dérangeante" (164). Tout cela peut être "dérangeant" mais l’Auteur, en philosophe, ne veut que la vérité, la lucidité. "Ne racontons pas d’histoire […] C’est la maladie qui désormais gouverne l’avenir et ce n’est pas un avenir" (125). "les faits sont les faits" (144).
Michel Malherbe ne va pas "nous raconter d’histoire". Ce sera la Maladie d’Alzheimer décrite brutalement. Mais en même temps le livre laisse bien apparaître des moments de bénédiction. Pourquoi ne sont-ils pas davantage soulignés ? Avançons donc dans le propos.
Des doutes à perte de vue
L’Auteur conçoit sa tâche comme scientifique, c’est-à-dire que rien ne doit être dit sans preuve avérée. Les récits d’accompagnants sur les manières d’être et les paroles de malades d’Alzheimer sont donc sujets à caution, partant trop facilement du présupposé que le résident en question serait "comme nous", orientant ses actes et ses dires vers un sens. "dans notre relation avec les patients alzheimer : nous avons beaucoup de difficulté à partager leurs pensées et leurs sentiments ; même par sympathie ou par raisonnement, leur vie propre nous est devenue en grande partie inaccessible" (135). Vincent Descombes dans Le parler de soi (2014) précisait une distinction qu’il faudrait faire entre "relation intersubjective" et "relation sociale" : "Une relation intersubjective s’établit entre deux sujets à travers des actes indépendants les uns des autres sur le modèle dialogique : dans un dialogue, je dis quelque chose pour être entendu, je pose une question pour qu’on me réponde, mais le seul fait de parler ou de questionner ne suffit évidemment pas à faire que quelqu’un m’entende ou me réponde" (Descombes : 229-230). "Une relation sociale s’établit entre des personnes lorsqu’elles coopèrent […] la première a accompli sa part d’un acte social à condition que la seconde en ait accompli la part complémentaire" (230). Tout "acte intersubjectif" n’est donc pas encore "un acte social". Par exemple, "entre le professeur et l’élève, la relation est intersubjective quand elle est seulement tentative de communiquer, mais elle est sociale quand elle est une relation d’enseignement, car le professeur n’a enseigné que si quelqu’un a été enseigné" (230). Dans la situation qui nous intéresse, Michel Malherbe se désole donc que ses actes en direction d’Annie ne soient jamais "sociaux", même si toujours des tentatives "intersubjectives".
Mais Malherbe revient chaque jour retrouver sa femme avec l’espérance qu’elle sera enfin là, se disant à chaque fois : "Aujourd'hui Annie va me reconnaitre et je vais la reconnaitre" et repartant le plus souvent déçu. Une phrase scande le livre : "Demain, je rendrai de nouveau visite á Annie".
La mystique levinassienne de l’Autre ne peut satisfaire un vrai philosophe
Le propos sera particulièrement acide à l’égard du discours éthique ambiant (dit "levinassien") qui ne dépasserait pas le niveau de l’opinion : "Ainsi l’éthique sait-elle se placer d’emblée dans le registre pratique, un registre où la vérité de l’énoncé est entièrement suspendue à sa force d’influence. "Alzheimer, une personne quoi qu’il arrive", dit le titre d’un récent ouvrage collectif. Pareil titre n’annonce pas une étude, mais édicte un mot d’ordre : tout être humain doit être considéré comme une personne […] Un noble propos mais qui évite ainsi la question qui fâche et qui serait-celle-ci : que reste-t-il, de fait, de la personne à un stade avancé de la maladie ?" (21). L’hagiographie n’est pas de la philosophie : "L’autre est devenu l’Autre. Cette représentation de la relation à l’autre fondée dans l’autre ne manque pas de grandeur ni d’attrait ; elle a été parée des plus belles couleurs. La légende dorée de Voragine multipliait en son temps, pour l’édification du lecteur, ces sortes de récits où l’innocence martyrisée triomphe à la fin du bourreau, impose aux lions le respect et transforme l’arène romaine en la communauté des saints" (36-37). L’Auteur veut, lui, toujours être du côté des faits (on se souvient : "les faits sont les faits" (144)). "l’addition […] se monte non seulement à une réelle diminution de qualité de vie mais à ce qu’il faut bien qualifier comme une réelle diminution d’être, une diminution d’être qui ne prête guère au rebond éthique cher aux défenseurs de l’autre. De là à conclure à une réelle diminution d’humanité, il n’y a qu’un pas qu’on n’osera pas tant il susciterait d’indignation. Mais l’indignation est une passion, elle ne vaut pas raisonnement" (48). L’Auteur semble ici accepter de prendre des gants. Mais dans bien des cas, il s’en passera : "quand je dis : "Annie a le visage fermé et le regard fixe, elle est absente", je ne me contente pas de dire que son apparence a changé et contredit son comportement habituel d’être toujours souriante ; je dis : "elle est absente"" : ce qui est dire : non seulement elle n’est plus Annie, mais elle n’est plus car Annie ne peut être sans être Annie. La perte d’identité a un coût ontologique" (187-188). La dépersonnalisation est supposée arriver à son terme : "Est-on sûr qu’il y ait encore quelqu’un dont on puisse dire qu’il souffre et qu’il meurt ?" (10).
Kant par défaut ?
"J’agirai donc, mais par obligation. Il faut être rendu aux extrémités pour n’avoir plus à connaître que l’impératif catégorique" (68). Mais pour agir de manière kantienne, il faut présupposer que l’autre est une "fin en soi", une "personne". Et là le scepticisme de Malherbe revient sempiternellement : "on ne gagne rien à délayer la notion de personne sinon à rendre sentimental le devoir que l’on a de considérer tel le patient" (79). Le devoir kantien ne peut être teinté de sentiments. Il postule la "personne". Il se donne comme règle de faire "comme si" l’autre était une personne. Et là encore Malherbe a du mal à être kantien jusqu’au bout. "On ne s’habitue pas vraiment au comme si ; et si l’on n’y prenait garde, on se ferait cynique tant la réalité contredit l’apparence" (103). Les doutes de l’Auteur sont tels qu’il en vient à voir de l’hypocrisie dans toutes les pratiques "kantiennes" du "comme si".
Hypocrisie à l’infini ?
"Entrez dans un établissement. La politique de l’établissement […] est à juste titre d’entretenir l’illusion d’une vie normale, et les familles, pourtant déchargées de la tâche, voudraient que cette vie "normale" soit "comme à la maison"" (93). L’Auteur a bien conscience des avantages que cela peut apporter aux résidents et pourtant, il résiste encore : "Sans ce souci de la convenance, sans ce sens de ce qui se fait [repas en commun, semainier dans un joli cadre, la visite] la maladie serait intolérable. Toutefois, l’on entre ainsi, et irrémédiablement, dans la sphère du mensonge" (67). L’EHPAD est également fait pour accueillir les familles, les proches. Est-ce un "mensonge" que de vouloir rendre plus agréable un cadre de vie ? Il y a du Alceste chez Malherbe. Un Alceste qui ne laisse pas d’être dur avec lui-même : "Mon semblable, ai-je dit ? Hypocrite ! Sa vie n’a plus rien à voir avec la mienne. Aujourd’hui même, ne me suis-je pas enfui avant l’heure ?" (67). Pourquoi serait-il si dur ? Parce que selon lui il ne faudrait pas édulcorer le mal réel qu’est Alzheimer.
Alzheimer comme mal absolu ?
Dostoïevski invoquait contre l’existence de Dieu la mort de l’enfant innocent. Michel Malherbe n’est pas loin d’invoquer son épouse Annie, transformée par la maladie. "Elle saisit délicatement un cheveu sur sa manche, le porte à sa bouche et le mâche consciencieusement. Mais comment une telle extravagance est-elle possible ? Comment une telle corruption de la conscience humaine peut-elle se faite ? […] Qui peut accepter qu’un être humain arrive à un tel état d’inhumanité, à une pareille corruption qui est pire que sa destruction ?" (283). On croirait ici entendre Primo Levi nous dire "Considérez si c’est un homme Que celui qui peine dans la boue etc.» (Si c’est un homme). Malherbe évoque "une expérience qui ne se partage pas, quoiqu’elle soit également faite par d’autres" (8). On peut le suspecter par moment de tomber dans ce travers de l’empathie égocentrée (note a) quand il dramatise à l’extrême le vécu du malade d’Alzheimer : "Annie tient entre ses mains sa Bible de poche qu’elle a tant pratiquée […] mais aujourd’hui, les caractères sont trop petits pour ses yeux. Elle déchire consciencieusement plusieurs pages. Elle s’arrête et dit distinctement : "il n’y a plus rien" […] Que puis-je à ce rien ? Rien. Jamais je ne connaîtrai le fond de sa misère" (128-129). Annie vit-elle ce qu’elle vit comme une souffrance atroce ? On peut en douter. Est-elle dans une souffrance psychique terrible en disant ce "rien" ou simplement dans une constatation blanche. C’est son époux qui, ici, vit cet événement comme une misère, parce que lorsqu’on se nourrit de livres on n’imagine bien le vide d’une vie qui ne le peut plus. De même lorsqu’il dit : "je crois savoir ce qui ne va pas, le monde a cessé de lui être familier ; ne lui reste que cette conscience de soi, souffrante. Or, dites-moi, quel est l’intérêt d’être encore conscient de soi quand on a perdu la connaissance du monde ?" (133). L’Auteur poursuit dans ce qu’il veut être la description du fond de l’horreur : "On leur met un grand bavoir autour du cou. L’irréparable devenu ordinaire, l’insupportable se répétant à chaque repas" (68). A Auschwitz, on usait de procédés dégradants pour humilier les hommes qu’on y avait enfermés et leur dénier par système leur qualité d’homme. Que Michel Malherbe soit choqué devant le spectacle d’adultes affublés de bavoirs peut s’entendre. Mais il n’y a pas ici la monstruosité d’un système à volonté déshumanisante. Il faudrait savoir raison garder. On voit à quel point l’Auteur a été atteint par l’expérience qu’il vit. Mais un doute apparaît. Devant la répétition de ses jugements noirs (qui se veulent objectifs, philosophiques, scientifiques) on ne peut pas ne pas suspecter un élément dépressif. Devant une musicothérapeute qui s’est démenée pour animer une activité musicale avec quelques résidents : "La musicothérapeute dit pour finir : "vous avez été formidables, merci de votre participation". Je ne sais s’il faut rire ou pleurer" (177). Peut-être qu’il ne faut ni rire ni pleurer mais accepter, à défaut d’admirer.
On l’a compris, la maladie d’Alzheimer ne serait pas un aspect d’un individu mais deviendrait son essence ("la maladie apparaît rapidement comme beaucoup plus qu’un simple événement qui ajouterait à l’existence (s’être marié, avoir un nouveau travail), ou qui lui retrancherait quelque chose (avoir vendu sa maison), car, à proprement parler, le patient est devenu alzheimer : cet accident est devenu son essence" (193)). L’Auteur va jusqu’à qualifier cette maladie de mode d’être "sortal". Il n’y aurait plus des "personnes" mais des "sortes" d’humains. "il s’apprésentait auparavant sous la sorte personne et […] dorénavant nous l’appréhendons sous la sorte alzheimer" (193-194). "Que cette désorientation soit devenue un mode d’être sortal, j’en ai la preuve dans le fait que les différences que je peux constater (il y a celle qui déambule, celle qui roucoule etc.) sont les variantes d’une même réalité uniforme qui est la cause de leur similitude. A la limite, je pourrais dire qu’ils sont substituables les uns aux autres" (194). Avec ce terme de "sortal" Malherbe semble ni plus ni moins retrouver Peter Singer et ses "non-personnes" (concept anglo-saxon de "non-person" appliqué aux personnes à handicap lourd ou aux comateux profonds). On retrouve aussi Catherine Malabou et son essentialisation de l’accident. "L’accident est devenu l’essence, le trait descriptif est devenu la sorte […] c’est la personne humaine elle-même qui se trouve corrompue par la maladie. Une conclusion qui effraie si fort qu’ordinairement on la refuse" (195).
Mais finalement, si "une chose ne souffre pas" en quoi la maladie d’Alzheimer serait le mal absolu que l’on nous relate ? Il ne le serait pour le proche qui fait le deuil de sa relation passée mais pas pour le malade. Et pourtant Malherbe semble répondre à cette question de manière négative. L’autre alzheimer ne serait plus une personne. Accordons-lui cependant d’être conséquent. Si l’autre n’est plus une personne, ni même un sujet, il ne souffre plus : "Prenez le monsieur distingué : "je suis perdu, je suis foutu" […] Ses propos me navrent, mais je lui prête une angoisse que peut-être il n’a pas" (244). On ne peut plus, ici, soupçonner Malherbe d’ "empathie égocentrée". "Le monsieur distingué répétait hier en se prenant la tête : "Mon Dieu, venez-moi en aide […] je ne suis plus rien, je n’ai plus de bouts" […] Tant de lucidité pathétique ne saurait laisser indifférent. J’éprouve de la sympathie pour ce malheureux […] Mais rapidement je perçois les effets de la maladie : son discours revient en boucle, de manière manifestement stéréotypée" (138). "Sans doute ne puis-je prouver ce propos, mais je ne voudrais pas devoir conclure que les patients alzheimer […] devraient être malheureux par principe" (245). Pas d’ "empathie égocentrée", donc. Mais parce qu’il n’y a plus d’empathie à avoir vis-à-vis de celui qui a été défini dorénavant comme pur objet ?
Est-on seulement rassuré parce qu’il nous précise : "une sorte est un déterminant ontologique et non un critère social" (194). Ce qui semblerait indiquer que si ontologiquement les personnes malades d’Alzheimer ne sont plus des personnes, socialement elles peuvent encore être considérées comme telles. L’inquiétude c’est que le social peut varier : pourra-t-on sans difficulté théorique accepter que dans telle société on ne les considère plus socialement comme des personnes et que l’on peut donc librement pratiquer l’euthanasie sur elles ? Le problème qui se pose ici n’est-il pas ici le même qui se pose quand un individu veut scientifiquement étudier les inégalités de races ? La folie meurtrière du nazisme a amené à ce qu’après la fin du conflit mondial on ne puisse plus formuler des propos qui sous-entendent une inégalité de ce type (en tout cas en France cela est devenu un délit). Et cela parce que certains discours sont déjà des actes, déjà des coups de poings psychiques infligés à des communautés minoritaires. Dire que l’on ne doit pas envisager l’inégalité des races, voire ne pas envisager que "race" est un concept robuste, est-ce n’être que dans le "politiquement correct" ? D’ailleurs, plus s’éloigne le cataclysme de la 2ème Guerre Mondiale, plus les hommes se laissent à nouveau aller à des discours qui auparavant auraient encore été intenables. Dire que "la personne qui se situe à un stade avancé de la maladie n’est plus une personne" ce n’est pas seulement énoncer un discours qui peut vouloir se prétendre objectivement neutre, philosophique avec toute la rigueur exigée, c’est aussi en appeler à des conséquences concrètes ou en tout cas à des comportements potentiels concrets. "Si ce n’est objectivement pas une personne, pourquoi continuons-nous à nous occuper d’elle. C’est une perte financière pour la société. Il faut cesser tout cela très vite". On pourrait très vite imaginer des analogies avec ces questionnements sur la nature humaine qui se déployaient dans l’Europe de l’entre-deux guerres (et notamment en Allemagne) à propos des handicapés. Les théorisations sur ces sujets ne sont pas sans conséquences pratiques (prenons-en comme exemple la tendance en Belgique à élargir l’euthanasie (qui est plutôt un suicide assisté) – problématique philosophique que Michel Malherbe n’évoque à aucun moment – sans doute parce que l’euthanasie d’Annie serait pour lui de l’ordre de la transgression la plus inacceptable). "J’aimerais croire qu’il s’est retiré dans son domaine intérieur, tel un ermite, pour y faire méditation […]. Rien de tel chez cet homme : il n’a plus d’énergie, il n’a plus d’appétit, plus rien ne tend sa vie, il s’est opéré en lui une sorte de relâchement constitutif, une sorte d’effondrement intime où il se défait. A ses pieds, une flaque… J’éprouve de la colère, du ressentiment même : qu’un homme soit perdu aux autres, soit ! Mais qu’il se perde à lui-même, je ne connais pas de plus grand mal. Qu’est-ce que ce monde où un homme peut être une offense à lui-même ?" (101). En quoi peut-il parler à ce point d’offense si ce n’est qu’il est arc-bouté à une représentation de la dignité qui serait purement d’apparence et d’efficacité sociale ?
Juger aussi la bouteille quand elle est à demi pleine (voire moins)
Dans le milieu du handicap une longue lutte sémantique a eu lieu pour refuser que le handicap prenne en otage la totalité de l’être. On a ainsi récusé le substantif "un handicapé" au profit de "personne handicapée" ou "en situation de handicap" - en d’autre terme en adjectivant le handicap plutôt qu’en le substantivant. Michel Malherbe fait ici l’inverse : substantiver Alzheimer (même si curieusement il lui supprime la majuscule comme on le ferait pour un adjectif). Dans le milieu du handicap on revendique qu’il y a d’abord une personne en face de vous, par delà ce corps défiguré ou ce psychisme défaillant.
L’Auteur semble affirmer que son Annie a fini par être un pur objet, sans reste. C’est ce "sans reste" qui pose problème. Que la maladie mécanise l’individu par ses stéréotypies, c’est indéniable. Mais même au moment où cet individu semble réduit à ce mécanisme deux choses restent possibles La première serait de toujours présupposer un "reste", du point de vue du patient lui-même (c’est la voie kantienne). La seconde serait considérer que Je suis celui qui conserve le reste de l’autre par ma mémoire, Je suis le garant symbolique de l’autre et cela personne ne pourra me le retirer. Ce qui certes nous attriste dans l’ouvrage de Michel Malherbe, c’est que l’on sente qu’il n’y arrive plus. Mais il existe aussi des Christian Bobin. Peut-être celui-ci a-t-il la chance d’être poète alors que Michel Malherbe ne serait que philosophe ? Etre poète serait accepter l’inattendu jusque dans sa pauvreté extrême, tandis que notre philosophe revendique toujours un minimum de maîtrise par les concepts. Et en cela, avec Alzheimer, le philosophe finirait toujours déçu ? ("communiquer avec elle est une épreuve car, malgré son sourire, c’est trop souvent connaître la déception" (8)) Comment peut-on être capable de ne pas trop attendre de l’autre en terme de "sens" ? Qu’est-ce qui fera la différence entre Michel (Malherbe) et Christian (Bobin) ? Telles des monades déposées sur l’échiquier du monde à des places différentes, ils ne peuvent que ressentir la situation Alzheimer différemment ? Chacun pouvant pourtant revendiquer une objectivité à sa manière, une sincérité descriptive totale.
Pour soutenir le présupposé "kantien" qu’il y a bien là encore une "personne", les témoignages ne manquent pourtant pas. Marie-Christine Bloch-Ory raconte ainsi : "Mme L. présente des troubles de la mémoire, elle ne reconnaît plus sa fille Florence qui vient la voir souvent dans l’unité protégée. Elle se demande d’ailleurs si cela vaut le coup de continuer à venir. Florence part en vacances mais n’en parle pas à sa mère : "qu’est-ce qu’elle pourrait bien comprendre, elle ne voit même pas quand je suis là ?" Deux jours après le départ de sa fille Mme L s’agite toujours au même moment : l’heure à laquelle sa fille lui rendait visite et un soir elle tombe. Nombre de personnes âgées tombent lors des départs en vacances de leurs enfants, comme si elles avaient perdu leur soutien, comme si on les avait lâchées, abandonnées" (Bloch-Ory, 2012 : 49-50). Malherbe en toute objectivité ne peut-il pas aussi prendre acte de ces récits comme des "faits" ? Les preuves humaines ne sont-elles pas des "récits" ?
Un témoin néanmoins…
Malherbe veut des preuves, il se méfie des témoins hagiographiques et pourtant on en vient à éprouver avec lui ce que l’expérience de la maladie d’Alzheimer ne parvient pas à détruire.
"Accordons néanmoins au témoin le pouvoir de témoigner" (213) concède-t-il quand-même. "Au témoin donc (à l’accompagnant) de raconter cette vie jusque dans sa dégénérescence, de donner malgré tout une force d’existence à ce déclin, quelque fatal qu’il soit, et de représenter dans une traduction respectueuse ce qui reste et restera en justice comme une authentique trajectoire d’identité" (212). Dans les "récits" sur le monde Alzheimer, il y a aussi l’affirmation que la joie existe. Malherbe ne peut le nier, bien qu’il semble toujours le faire à regret. Il semble aussi que l’Auteur le sente lui-même et qu’il lutte parfois philosophiquement contre le démon du soupçon et du découragement qui le tenaillent.
Michel Malherbe nous raconte donc aussi des moments de joie simple : "Etrange communication, parfois drôle, parfois émouvante" (12). "il y a aussi ces phrases fulgurantes qui passent au travers des mailles de sa démence». "La petite dame boulotte s’est glissée au milieu du chœur […] elle rayonne comme un soleil" (174). Ces enfants qui se glissent inopinément dans l’EHPAD, introduisant soudain un air de folie que les vieux reçoivent par contagion. Et puis ce chanteur à la moustache qui chante Brassens. Ce qui se passe alors, ce sont aussi des "faits" : ces "sourires qui se dessinent, éclairant des visages jusque-là fermés" et puis ces "refrains les plus fameux qui sont chantonnés" (127). Cela aussi existe, mais si l’Auteur peut le noter objectivement, il ne le fait pas ressortir pour autant. Il y a des moments de joie en EHPAD et il y a aussi de l’affection qui naît. Michel Malherbe n’y échappe pas : "Au hasard de mes visites, je me suis pris de sympathie pour plusieurs des résidents de l’Unité. La lente corrosion de leur personne m’est une peine […] C’est en amitié que je m’honore d’attribuer au monsieur distingué ou à la dame qui roucoule une qualité d’être, une "vertu" personnelle bien supérieure à leur dégénérescence manifeste […] je renouvelle mon effort à chaque visite et je me dis : "ils sont plus qu’ils ne sont", ils sont chacun singuliers, dignes d’être estimés et honorés pour eux-mêmes. Effort déçu, la première chose que je vois en eux est leur déclin […] Et pourtant il n’y a pas lieu de renoncer" (267). Levinas, Kant, Scheler qui ont été dits les uns après les autres ne pas s’avérer suffisants, se combinent pourtant ici. "Reste aussi ce qui demeure de l’attachement, mais le risque est grand de tomber dans la pitié ou dans la compassion, cette manière de tenir l’autre "à bout de sentiment" ; et le risque également grand de se raconter le passé pour ne pas voir le présent" (271). "Reste encore le devoir d’être fidèle […] Il est des moments où l’on ne tient plus que par cet impératif abstrait" (271). "Reste le courage de lier l’instant à l’instant, la visite à la visite. Mais qui possède la recette du courage ?" (271).
Et à côté de la joie simple il y a des moments encore plus forts où Annie trouve un fil de l’humanité jamais sectionné : "On pose sur les genoux d’Annie son dernier petit-fils, nouveau-né. Elle le prend dans ses bras. Le petit pleure. Elle dit alors distinctement, à la surprise des parents : "Mais qu’est-ce qu’il a, ce petit bébé ? Pourquoi pleure-t-il ?». Etrange et immense pouvoir de l’enfance. Pouvoir assez fort pour causer au fond d’Annie une émotion si pleine que dans ce court instant elle refait le geste, elle retrouve le mot […] de cette confondante sollicitude des femmes pour les tout-petits" (241). Les "non-personnes" ne sont pas si "non-personnes" qu’on avait bien voulu les cataloguer, quand une occasion réactive leurs sentiments. Ou encore : "Je tente de marquer le rythme en imprimant un mouvement au fauteuil d’Annie. Elle aimait autrefois la danse. Elle m’arrête et me prend la main, d’un geste si spontané que j’en suis tout ému. Instant de grâce" (15-16).
Malherbe en vient , au fond de la pauvreté, à pouvoir interpréter ce que cela nous apporte de fort sur l’humain qu’un être reste jusqu’au bout : Parlant d’un homme progressivement amoindri par la maladie : "Cette maladie qu’il n’a certainement pas voulue est un acte de vie de sa part, un acte qui peut s’être d’abord exprimé dans le refus ou la révolte puis dans une forme de résignation ou d’acceptation" (198). Et puis enfin : "Annie […] lit une revue […] la revue est à l’envers, ce qui ne paraît pas la troubler […] je me dis : imiter, c’est une manière de continuer car, si le propre du souvenir est de s’attarder sur le passé, le propre de l’imitation est de s’ouvrir au futur […] Voilà l’ultime résistance, celle d’une vie qui se reprend dans l’adversité ; voilà la victoire décisive, celle de l’humanité des hommes surmontant en chacun le déclin de chacun. Faire plus que durer : continuer, cette action n’appartient qu’au genre humain […] Et moi aussi je continuerai, visite après visite, sans attendre de succès, je continuerai par la force de l’habitude et avec l’élan désespéré d’une nouvelle espérance, chaque jour ranimée chaque jour déçue" (289-290).
"Reste comme support, dans la coprésence, la présence d’un corps vivant qui dure, quoique subsistant sans fin ni raison, mais subsistant quand même" (271). Tout en lui déniant la qualité de sujet présent, l’Auteur ressent bien que son rapport à Annie reste celui du maintien de sa qualité de sujet quand-bien même elle ne le porterait plus par elle-même. Et c’est pourquoi il peut lui dédier son livre "A Annie". Et puis il dédiera aussi à cette communauté, ce réseau humain que nous pouvons former : "Puisse cette chronique être un hommage rendu à tous les résidents de l’unité Le Nôtre qui, au fil des jours, des mois, des années, ont été ou sont encore les compagnons d’infortune d’Annie. Qu’elle soit également un témoignage de gratitude envers le personnel du parc de diane, digne d’être estimé et honoré jusque dans ses tâches les plus humbles" (Note p.12). Certes, il le place en note de bas de page mais il dit d’une certaine façon ce que philosophiquement Leibniz répond à Locke : nous portons la mémoire de l’autre quand-bien même il ne peut plus la porter tout seul. Nous somme garant symbolique de l’autre. Ou ce que Ricoeur pourrait aussi signifier de son identité narrative, prolongée comme il se doit par la communauté qui nous entoure. Certes, dans une société qui serait totalement atomisée ou chacun serait un inconnu pour chacun, ce co-portage n’existerait plus, mais ce ne serait plus l’humanité.
CONCLUSION
L’Auteur est, à notre sens, resté enfermé dans la conception philosophique moderne, celle qui définit la personne de manière atomistique (dans la droite ligne des "philosophes du contrat", Hobbes, Locke, Rousseau) en la réduisant à ses performances présentes (à son autonomie individuelle). Cette conception (qui a la nostalgie de l’objectivité du naturaliste) ne peut que faire de Alzheimer un écueil indépassable.
Avec toutes les réserves théoriques que nous avons esquissées, le livre de Michel Malherbe reste un livre fort, un témoignage indispensable à celui qui veut comprendre les hommes et ici la situation Alzheimer. S’il n’y avait ce mélange des genres qui casse un peu l’unité de l’œuvre (Essai stylistiquement du XVIIIe s greffé sur une chronique au ton contemporain) ce livre pourrait être classé dans la même veine que le chef d‘œuvre sur le handicap qu’est le livre de Robert Murphy (Vivre à corps perdu).
Il faut en tout cas lire cet ouvrage dans toute son extension. Dans ses moments cyniques et sceptiques, certes, mais il ne faudrait pas l’y résumer. Michel Malherbe, bien que philosophe rompu à l’exercice de l’authenticité froide, n’est pas toujours aussi lucide sur ce qu’il fait passer qu’il ne le croit. C’est ici un témoignage irremplaçable, dont on peut tirer tout autre chose que du désespoir. Michel Malherbe nous raconte son amour pour Annie et sa perte inconsolable. "vous n’avez pas connu Annie à vingt ans ; elle était…merveilleuse" (128). Il nous dit en filigranes la peur de ne pas avoir l’énergie suffisante pour continuer, la peur d’abandonner Annie.
Merci à Michel Malherbe de nous livrer ce témoignage sans fard qui a évidemment été une catharsis pour lui, tel Robinson envoyant une bouteille à la mer et restant par là encore en relation intersubjective. Nous aimerions lui dire que sa bouteille à la mer a elle aussi été reçue et, même s’il ne le sait pas, que nous avons eu la chance d’être avec lui en relation sociale.
Note :
(a) Le concept d’ "empathie égocentrée" que nous avons développé dans notre ouvrage La Philosophie face au handicap (pp.95-105) rend compte de cette situation très fréquente où la personne dite valide, croisant une personne en situation de handicap, fait un effort immédiat pour "se mettre à sa place" (empathie) - ce qui produit un dégoût ou un frisson d’effroi, car nous imaginons qu’il nous serait insupportable de ne pas avoir de bras, d’avoir des jambes tordues, de parler avec une élocution hachée. Notre empathie reste donc "égocentrée" - centrée sur notre manière présente de ressentir et de juger la vie et nous amène à faire un paralogisme, une erreur logique : nous imaginons la personne handicapée malheureuse et en souffrance permanente.
Références bibliographiques :
Bloch-Ory, M.-C. (2012) "De contenir à soutenir. Vers un changement de paradigme dans les établissements d’accueil des personnes âgées" Mémoire de Master 1 de philosophie pratique, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée.
Descombes, V. (2014). Le parler de soi, Paris, Gallimard.
Levi, P. [1947] (1990). Si c’est un homme, Paris, Julliard.
Malabou, C. (2007). Les nouveaux blessés De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, Bayard.
Malherbe, M. (2015). Alzheimer. La vie, la mort, la reconnaissance. Une chronique et un essai philosophique, Paris, Vrin.
Quentin, B. (2013). La Philosophie face au handicap, érès.
Ricoeur, P. [1990] (1996). Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil