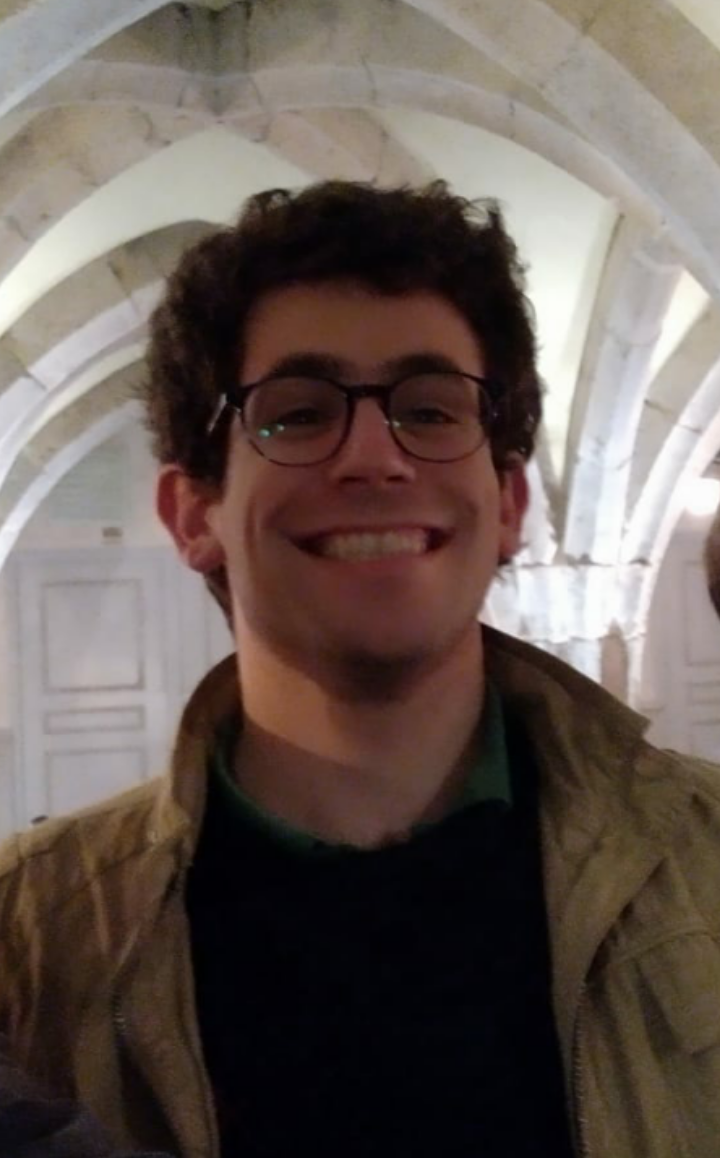Par Charles MIDOL
Interne au CHU de Lille et étudiant du Master d'Ethique Médicale de l'Université Gustave Eiffel, Charles Midol se passionne à la fois pour le diagnostic des maladies rares et pour les questions éthiques soulevées par l’évolution des techniques médicales. Il a collaboré avec le laboratoire lillois INCLUDE, spécialisé dans le domaine des données massives en santé.
Article référencé comme suit :
Midol, C. (2021) « L’intelligence artificielle peut-elle poser un diagnostic ? Enjeux éthiques d’une définition » in Ethique. La vie en question, janvier 2021.
A-t-on besoin d’un médecin pour poser un diagnostic ? À en croire les articles qui paraissent régulièrement (1), les progrès de l’intelligence artificielle permettraient à l’ordinateur de poser un diagnostic avec autant, voire plus de fiabilité qu’un clinicien entraîné. Nos patients accepteraient-ils d’être soignés par un ordinateur ? Les médecins accepteraient-ils d’être remplacés par une machine ? Qui devrait alors porter la responsabilité d’une erreur diagnostique : le concepteur, le développeur, le clinicien (2) ? Que resterait-il à la relation médecin-malade : l’empathie, le toucher, la décision ?
En vérité, la question du diagnostic en intelligence artificielle n’est pas aussi récente qu’on voudrait nous le laisser croire. En 1973 apparaît un programme nommé MYCIN pour guider le clinicien peu expérimenté dans le traitement des infections bactériennes (3). Il sera rapidement suivi par des logiciels experts : ANEMIA en 1986 ou TEGUMENT en 1987 (4), qui à chaque fois proposent de poser un diagnostic à la place de l’esprit humain…
La nouveauté réside aujourd’hui dans le développement de l’apprentissage profond ou deep learning et des données massives dans le domaine de la santé. Le logiciel est désormais capable d’apprendre par lui-même : plus de nouveaux cas lui sont présentés, plus il devient performant. L’essor des données massives en santé ouvrirait donc des perspectives insoupçonnées dans le diagnostic et la compréhension des maladies. Dans le diagnostic des lymphomes, des tumeurs cutanées ou de la rétinopathie diabétique, plusieurs logiciels se sont récemment fait remarquer par leur capacité à poser un diagnostic avec plus de justesse que le médecin (5).
Mais que font exactement ces logiciels, dans quelle mesure permettent-ils de poser un diagnostic ? Il s’agit à chaque fois de faire lire à l’ordinateur une image (une coupe de biopsie ganglionnaire ou cutanée, un fond d’œil) qu’il classera dans une catégorie diagnostique connue (un lymphome du manteau, un mélanome, une rétinopathie exsudative). Ce n’est donc qu’une étape du diagnostic, une compétence technique déléguée à la machine. À chaque fois également, la compétence diagnostique du logiciel est comparée à celle de l’homme. Le médecin reste donc l’étalon-or du diagnostic.
Serait-ce donc simple de poser un diagnostic ? Ne s’agirait-il que d’une relation logique entre un signe, en l’occurrence une image, et une maladie ? Une relation nécessaire et suffisante entre un symptôme et sa cause ? Il suffirait alors de convertir le langage biologique en langage informatique. Dans ce cas, le médecin aurait tout intérêt à déléguer cette tâche technique et fastidieuse à la machine. Le clinicien gagnerait du temps et le patient de la précision…
Est-ce vraiment cela poser un diagnostic ? Non, ce n’est que la dimension technique d’un acte complexe et humain. La question de l’intelligence artificielle en santé interroge, car elle n’assume pas l’exhaustivité du travail clinique, elle ne considère l’homme que sous le versant objectif et technique du diagnostic. L’expérience clinique nous fait pressentir que l’acte diagnostique est beaucoup plus complexe, qu’il débute dès le premier regard ou la première poignée de main et qu’il s’arrête lorsque la question muette posée par la plainte du malade a trouvé une réponse.
Nous souhaitons prendre un peu de hauteur sur cette problématique. Penser que la machine peut nommer une maladie comme l’esprit humain le fait, c’est réduire l’acte diagnostique à son versant analytique, à une suite d’implications logiques pondérées par des probabilités. Cette tentation intellectualiste n’est pas récente, elle accompagne l’histoire de la sémiologie médicale.
Nous pensons au contraire que le diagnostic n’a de sens que comme fruit d’une relation singulière entre un malade et son médecin, comme concept entièrement tourné vers le soin et la prise de décision.
La tentation d’une réduction analytique du diagnostic médical
Est attribuée à Hippocrate la paternité des premiers signes cliniques. En entrant dans la chambre du patient, le faciès hippocratique annonce au médecin une issue rapidement défavorable. Le nez est pincé, les yeux enfoncés, les tempes affaissées : tous ces signes appellent une mort prochaine. Ainsi émerge au cours des siècles une discipline que Littré nommera sémiologie, une « partie de la médecine qui traite des signes des maladies » (6). Cette partie qui utilise des symptômes subjectifs et des signes objectifs confère à la médecine sa scientificité. Il s’agit de discerner à travers ce qui est perçu, et prioritairement à travers ce qui se voit, la vérité d’une structure morbide à l’œuvre chez le patient. Foucault consacre cette science médicale qui s’exerce sous l’œil vigilant du médecin : « les symptômes laissent transparaître la figure invariable, un peu en retrait, visible et invisible de la maladie » (7).
L’acte diagnostique permet une objectivation de la souffrance du malade par le clinicien et met en avant sa capacité de normalisation : l’homme de l’art est capable d’extraire du discours du patient les éléments revêtus d’une pertinence pathologique, d’en pondérer la significativité mais également de standardiser la plainte du patient sous la forme de signes prototypiques. Pour Foucault le signe est revêtu d’objectivité car il traduit le langage naturel de la maladie : « la pensée clinique ne fait que transposer, dans le vocabulaire plus laconique et souvent plus confus de la pratique, une configuration conceptuelle » (8). La clinique devient le corrélat perceptif du langage de la maladie, seul celui qui maîtrise cette pathoglossie est capable de la comprendre. L’objectif est clairement fixé : « à l’horizon de l’expérience clinique, se dessine la possibilité d’une lecture exhaustive sans obscurité ni résidu […] : toutes les manifestations pathologiques parleraient un langage clair et ordonné » (9).
Cette recherche d’un langage de la maladie se double d’un autre finalité : la quête d’une objectivité de la clinique médicale. En quoi le symptôme est-il le reflet d’une vérité organique ? Au XIXème siècle, la réponse à cette question réside dans l’anatomo-pathologie. Pour Bichat, l’examen anatomo-pathologique est le pendant de l’examen clinique, plus particulièrement l’examen des membranes. La question de la surface reste fondamentale : cette surface du corps humain qui restait infranchissable et opaque (avec un stéthoscope on peut, tout au plus, entendre ce qui se vit quelques centimètres sous la peau) s’expose de façon réelle à l’œil du pathologiste. Le signe clinique, produit de l’examen médical, est insuffisant pour être un reflet objectif du phénomène morbide. Grâce à l’anatomo-pathologie, l’œil franchit la barrière de la peau pour se trouver confronté à une nouvelle étendue, le tissu. Grâce à la pathologie, « on passait d’une perception analytique à une perception des analyses réelles » (10). Foucault ouvre une question toujours actuelle : en quoi la perception du tissu lésé offre-t-elle plus de réalité que la perception du sujet malade et de ses symptômes ? Est-ce plus réel de se pencher sur un microscope qu’au lit d’un patient ? C’est une perception analytique qui justifie cette hiérarchie d’objectivité. Par analogie avec les sciences expérimentales, décomposer la substance en éléments de plus faible taille permet d’en comprendre le fonctionnement.
Le diagnostic, une logique des opérations ?
Le clinicien serait donc détenteur d’un accès direct à la vérité de la maladie ? Le regard clinique, revêtu de distance et d’objectivité se définit alors comme « un acte perceptif sous-entendu par une logique des opérations » (11). Une telle définition réduit clairement la clinique à un processus analytique, reléguant au deuxième plan la perception réelle et érigeant le diagnostic en un acte intellectuel et essentiellement logique. Le champ est laissé libre à l’interprétation réductrice d’une machine capable de poser un diagnostic, d’une intelligence artificielle plus habile que le médecin dans le domaine du raisonnement logique. Ainsi, les recherches actuelles sur l’intelligence artificielle en santé se focalisent sur l’élaboration d’ « ontologies » c’est à-dire de listes de symptômes ou de manifestations prototypiques décrivant de façon exhaustive l’expression d’une pathologie donnée (12). Ce langage commun à la machine, au médecin et au patient serait alors la base du raisonnement diagnostique.
Foucault est également en faveur d’une maladie qui serait langage ou plus précisément d’une grammaire de la maladie : « les choses sont offertes à celui qui a pénétré le monde clos des mots ; et si ces mots communiquent avec les choses, c’est qu’ils obéissent à une règle qui est intrinsèque à leur grammaire » (13). Cette hypothèse est séduisante et justifie l’adéquation de la parole du médecin à la réalité de la maladie. Un logos commun expliquerait à la fois l’enchaînement morbide et la structure rhétorique de la langue médicale.
Derrière cette définition grammaticale du raisonnement médical se profile le spectre d’une réduction analytique de la clinique. La relation qui unit l’acte perceptif et la dénomination médicale n’est ni nécessaire ni suffisante, elle ne traduit pas un processus logique mais empirique. La terminologie médicale n’est ni toute puissante ni mathématique. Elle ne constitue qu’un outil de travail au service du diagnostic et s’éloigne ainsi du fonctionnement informatique.
La prétention scientifique de la médecine se heurte rapidement à ce qui fait son essence : il n’y pas de médecine sans maladie, donc pas de médecin sans malade. En d’autres termes, la volonté de généralisation attribuée au diagnostic est limitée par la singularité du malade placé en face du clinicien. La médecine incarne de façon particulièrement claire le paradoxe de la confrontation de la connaissance générale au cas particulier. La qualité d’un chirurgien ne se mesure pas à sa connaissance de l’anatomie mais à sa capacité à opérer le patient qui se présente à lui ! On ne prononce pas une sentence diagnostique comme une loi de la mécanique céleste : la capacité de généralisation importe peu au malade, qui cherche avant tout le soulagement ou la résolution d’un symptôme. La médecine se démarque d’emblée de toute autre pratique savante par son abord direct avec la réalité. Le diagnostic n’échappe pas à cette règle : il est établi en vue d’un bénéfice concret.
Le diagnostic est tourné vers l’action
N’est-il pas absurde de poser un diagnostic si cela ne permet pas d’aider le patient qui se présente avec sa plainte ? La visée opérative du diagnostic médical apparaît dès le premier contact du médecin avec le patient, elle est sous-entendue par le contrat de soins tacite établi entre les deux parties. Plus précisément, elle découle de la visée compassionnelle au cœur de toute pratique soignante : la justification de l’activité médicale, c’est le soulagement de la souffrance d’autrui. L’arsenal thérapeutique se révèle parfois indigent : quand la maladie est trop rare, trop complexe ou trop avancée pour promettre un quelconque espoir de guérison. Ou bien la plainte est trop vague, dénuée de substrat objectivable, et médecin comme malade peinent à lui donner un nom (c’est le cas de ce que l’on appelle les syndromes douloureux). Ou bien la seule proposition est l’expectative hippocratique, dans ce cas, on laissera libre cours à la nature pour attendre la guérison. Dans ces trois situations, le diagnostic n’est pas pour autant dénué d’importance, il ne conduit à aucune sanction thérapeutique mais reste revêtu d’une certaine valeur opérative, il cristallise la plainte du malade et propose une orientation vers son soulagement.
Le diagnostic médical n’est pas neutre, il porte en germe l’espoir d’une guérison pour le patient et d’une action pour le médecin. Il serait donc inadapté de considérer le patient sous le seul regard d’une catégorie diagnostique. On n’agit pas en médecine comme en botanique, le sujet malade brille par sa singularité : « car ce qui fait que la médecine est médecine est qu’elle a pour objet direct le contraire d’un objet : une personne humaine singulière. La relation à la maladie est donc inséparable de la relation à l’homme malade, ce qui fait de l’éthique une dimension constitutive de la médecine » (14). Le jugement médical ne peut se contenter d’un avis catégoriel et scientifiquement neutre, il s’applique à un patient, dans toute sa densité humaine, il est en lui-même un jugement éthique.
Le soin rend nécessaire de formuler cette importante distinction entre outil et finalité. Le diagnostic n’est qu’une réponse, rigoureusement formulée, assistée si nécessaire de moyens techniques et appuyée sur des connaissances scientifiques, d’un homme face à la souffrance d’un autre homme. Ce qui justifie le médecin ce ne sont pas ses connaissances, mais ses actes. « De nos jours, celui qui connaît la maladie est un scientifique – fût-il par ailleurs médecin praticien et diplômé en médecine. Le médecin n’est pas l’homme qui connaît la maladie. Même s’il est aussi un scientifique, le médecin est celui qui soigne et soulage son patient. Ni plus, ni moins. » (15) Ces mots de Dominique Folscheid sont sévères mais ils ont le mérite de replacer le médecin dans son activité centrale : le soin.
Le diagnostic est un acte humain, qu’il soit intuitif, scientifique ou rationnel, il est porteur d’une profondeur qui ne peut se limiter à une opération logique. Mais alors quel sens lui donner ? S’il n’est pas le fruit d’un processus uniquement rationnel, vers quoi se dirige-t-il ? Son point de départ, c’est la douleur du patient : il faut « répondre à l’appel d’un être humain en péril » (16). Quelle est sa finalité ? « Cette primauté de la personne, qui seule donne son sens à l’acte médical, fait que la médecine est indissociable de l’éthique : soigner, c’est toujours soigner quelqu’un » (17). Il n’est d’éthique que lorsqu’il faut trancher, prendre une décision qui aboutira à une action. Poser un diagnostic, c’est décider, non pas de la mort ou de la vie, mais du terme à apposer à la souffrance du patient, car de ce terme découleront des moyens pour le soulager. Le clinical judgement des anglo-saxons rend hommage à cette dimension décisionnelle du diagnostic : de celui-ci dépendra ce que nous aimons appeler la sanction thérapeutique.
Diagnostiquer c’est donc sortir de cet état d’indécision dans lequel sont placés le patient et son médecin. C’est prendre une position face à une situation clinique parfois complexe, toujours particulière, avec s’il le faut des données biologiques ou radiologiques. Il faut prendre une décision pour chercher à soulager la plainte. Ce mot qu’utilisent les médecins pour évoquer la demande spontanée du patient, révèle un sens plus profond. Le médecin est dérangé, remis en cause, par cette preuve apparente de mauvaise santé, il est sommé d’apporter son soutien, de briser la torpeur de la maladie, somatique ou non, qui alourdit son patient. Le diagnostic est une prise de position, un choix, et pas seulement un processus rationnel qui guide la décision.
Le caractère prudentiel du diagnostic
C’est dans le domaine de la délibération que se place l’exercice du diagnostic. Il est tourné vers une fin évidente, la guérison ou le soulagement de la maladie. C’est ce que nous rappelle Aristote : « Un médecin qui délibère en effet ne se demande pas s’il doit apporter la guérison […]. Au contraire, une fois qu’on a posé la fin, on regarde la question de savoir comment et par quels moyens on peut l’atteindre et si plusieurs moyens paraissent en mesure de l’atteindre, on examine quel est le plus facile et le plus beau. » (18) La médecine, tout au moins la clinique, n’est pas une science. Elle n’est pas à la recherche d’une suite de processus logiques qui la mèneront vers sa fin, mais possède un but déjà trouvé : soigner. L’objectif étant fixée, il reste au clinicien un moyen pour chercher à l’atteindre, le diagnostic. Il n’est pas rare que le médecin pose plusieurs diagnostics pour un même patient, soit que le malade présente plusieurs maladies concomitantes, soit qu’il existe plusieurs possibilités diagnostiques mutuellement exclusives. Dans l’hypothèse où les différentes hypothèses diagnostiques se valent mais se contredisent, il appartient au clinicien de délibérer en faveur de l’une ou de l’autre. Une fois de plus, c’est le bénéfice thérapeutique qui permettra de juger du meilleur moyen pour obtenir le soulagement du patient. Le plus beau diagnostic n’est donc pas l’hypothèse de la maladie la plus rare ou le fruit du raisonnement le plus complexe, ni le plus irréfutable mais celui qui soulagera le mieux.
Dans un article de 1996, Paul Ricoeur énonce trois niveaux du jugement médical dans l’exercice clinique : prudentiel, déontologique et réflexif. Pour le philosophe, ce sont ces trois caractéristiques qui différencient l’éthique clinique ou thérapeutique de la bioéthique, considérée comme le questionnement soulevé par la recherche fondamentale. Le privilège de la clinique c’est sa confrontation directe avec le réel, avec l’humain souffrant. De la relation du malade à son patient naît l’essence du questionnement éthique qui doit guider le praticien. C’est la caractéristique prudentielle qui nous intéressera le plus. Elle est l’écho de la phronesis aristotélicienne, il s’agit d’une « sagesse pratique d’une nature plus ou moins intuitive résultant de l’enseignement et de l’exercice » (19). Elle se place à l’intersection entre le général et le particulier, entre la science et l’expérience, entre le raisonnement et l’intuition. Ricoeur nous éclaire sur la valeur constitutive de ce niveau prudentiel dans l’exercice médical. C’est dans ce lieu humain et singulier que se cristallise l’essentiel de la pratique médicale. C’est là que se rencontrent la connaissance et l’agir, là que la relation singulière devient proprement médicale, mais c’est aussi là que le clinicien doit déposer ses certitudes pour se confronter au réel. Cette densité de la clinique est le creuset de toute réflexion éthique : « c’est de la dimension prudentielle de l’éthique médicale que la bioéthique au sens large emprunte sa signification proprement éthique » (20).
L’exercice du colloque singulier, relation privilégiée entre médecin et malade, implique un contrat tacite. C’est autour de ce noyau éthique que s’organise toute la démarche médicale, le clinicien accepte de soigner le patient, le malade accepte de suivre le protocole thérapeutique qui lui sera proposé. Ce niveau prudentiel de l’exercice médical nous permet de situer avec précision le lieu du diagnostic pour plusieurs raisons. C’est d’abord là que se rejoignent la généralité de la pathologie dans sa définition descriptive et scientifique et l’unicité de la situation du patient devant nous. C’est également le lieu où se fonde l’intérêt commun du médecin et du patient : par compassion mais aussi par professionnalisme, le clinicien se doit d’apporter au malade une réponse qui lui permettra de dépasser sa souffrance et de lui donner un nom. Dans cette interface unique se retrouvent à la fois le théorique et le pratique : par ce contact avec la réalité, le médecin devient réellement clinicien en se révélant apte à émettre un jugement sur une situation singulière et réelle. Il s’agit d’un pivot entre le raisonnement et l’action, patient et médecin prennent leur bord et choisissent de s’y tenir. Mais surtout l’action du médecin devient véritablement thérapeutique, il considère l’humain dans son insigne dignité et tente de l’y rétablir là où elle se trouve lésée. Enfin c’est le lieu du risque dans lequel se trouve plongée toute action humaine : risque d’échouer pour chacune des deux parties, risque de se précipiter – par impétuosité ou par affection – risque de s’engager bien au-delà de ce qu’impose la relation professionnelle.
Ce niveau prudentiel appliqué au diagnostic médical pousse à l’extrême la vocation particulière et éthique que peut porter la notion. Nous sommes bien loin d’une classification nominaliste exprimée par une machine ou un esprit sèchement mécanique, bien loin de la logique irréfutable que l’on souhaiterait attribuer à la démarche diagnostique. Mais ne nous méprenons pas : si cette notion est si riche c’est bien parce qu’elle est capable d’englober toutes ces dimensions. Non, on ne saurait reprocher au malade d’attendre du médecin d’utiliser une démarche rigoureuse et rationnelle pour soigner son patient, pas plus qu’on ne pourrait reprocher au médecin d’agir avec une candide humanité en prenant le parti d’oublier sa science pour soulager la douleur du malade. Cet art de bien soigner ne se situe ni dans les nébuleuses élucubrations médecins de Molière ni dans les disciplines scientifiques mais dans la capacité soignante de la médecine concrète, la simple conviction qu’il est nécessaire de prendre une décision pour aider son patient…
Conclusion
L’objectif de notre propos n’est pas de jeter un doute sur l’utilité de la technique dans le domaine médical mais de rendre à la notion de diagnostic une dimension qui nous semble négligée. Une vision purement analytique du diagnostic médical, celle d’un processus logique que l’on pourrait déléguer à un logiciel n’est qu’une définition incomplète de cet exercice clinique. La médecine constitue un lieu humain d’une incomparable densité : la relation entre un médecin et son patient est un noyau éthique à partir duquel se déploient de multiples dimensions. L’habitude créée par la routine fait oublier au médecin la richesse humaine à laquelle il est confronté dans son activité quotidienne. La philosophie rend à l’homme la capacité de discerner la profondeur de son action : il ne s’agit pas d’un lieu d’expérimentation ou de réflexion mais simplement d’un lieu d’où la vie jaillit. Avec ses lenteurs et avec ses douleurs, la clinique invite le couple malade-médecin à un dévoilement. Dévoilement plus ou moins pudique du malade vis-à-vis de sa propre souffrance et positionnement du médecin sur ce qu’il a perçu de sa plainte. Cette confrontation avec le réel qui se livre est parfois trop douloureuse. Le clinicien se replie alors dans une distance protectrice. Cette prudence, cette économie de la relation ne doit pas être trop hâtivement jugée. S’il s’éloigne ou se réfugie derrière ses capacités techniques c’est parce qu’il veut se protéger mais aussi protéger sa capacité à soigner. La technique est un outil qui distancie l’homme de la maladie, elle lui donne des contours, une forme qui devient manipulable mais aussi un fondement, une explication et donc une possibilité de remédiation. En médecine, la technique est utile car elle est efficace.
Poser un diagnostic est un préliminaire quasi indispensable à tout acte thérapeutique. Comment se fait-il que l’homme ait besoin de nommer avant de soigner ? La maladie n’a-t-elle pas par elle-même suffisamment de consistance sans qu’il soit nécessaire de lui donner un nom ? La compassion, n’a pas non plus besoin de mots pour s’exprimer, elle agit tout simplement. La sollicitude pour autrui ne s’arrête pas à ces considérations nominales ! L’importance donnée à la notion de diagnostic est une conséquence de la prétention rationaliste de l’esprit humain : nommer c’est donner de l’existence à un phénomène muet. On baptiserait donc une maladie comme un enfant ? Pour lui donner une existence aux yeux du monde ? Cette exigence nominaliste n’est pas qu’une lubie du rationalisme. Nommer c’est donner accès à la généralité et donc à la compréhension. Il n’y aurait pas de sciences, pas de réflexion, pas de compréhension des processus morbides si les maladies n’avaient pas de nom. Nommer c’est tisser un lien entre le particulier et le général, c’est faire en sorte que la connaissance puisse venir au secours de l’expérience. Nommer un phénomène, c’est acquérir une certaine autorité sur lui, le comprendre et le plier à ses propres exigences. Il est donc évident que le diagnostic est nécessaire pour faire de la maladie un objet de science. Et cela est heureux, l’étude des processus morbides a permis à l’homme de comprendre le fonctionnement de son corps et de remédier aux situations les plus pathologiques c’est-à-dire les plus douloureuses…
Cette exigence scientifique de la médecine ne doit pourtant pas faire oublier à l’homme qui soigne que tout ne peut pas être dit. Il y a dans la perception de l’individu malade quelque chose d’ineffable. Ce non-dit n’est pas un point aveugle dans la relation médicale mais une partie prenante. La réalité ne peut être intégralement objectivée, on peut tout au plus en créer des modèles perfectionnés. Il existe une portion de la perception de la maladie qui ne peut être verbalisée et qui ne deviendra donc jamais objet de science. Pour autant, cette couche de la perception humaine ne doit pas être trop rapidement écartée. D’abord parce qu’elle ne possède pas moins de réalité que les données objectivables mais aussi parce que c’est elle qui guide le médecin expérimenté vers le meilleur traitement. Qu’on l’appelle intuition, sens clinique ou expérience, cette portion non mesurable de la perception est fondamentale pour l’exercice de la décision médicale. Nous posons l’hypothèse que ce perçu non objectivable est ce qui fait l’essence de la décision thérapeutique. Le médecin le moins expérimenté et le moins empathique percevra la détresse physique de celui qui lui fait face, sera pressé d’agir par la souffrance d’autrui. C’est notre commune humanité, la résonance de nos corps qui traduit en action cet ineffable langage.
Être un bon médecin, c’est donc rechercher ce subtil équilibre entre science et intuition, entre rationalité et empathie. Ce qui guide le scientifique c’est la recherche de la vérité, ce qui guide le clinicien c’est la compréhension de l’être. Ces deux attitudes sont deux facettes d’une pratique commune. Ce qui fascine Foucault dans ses recherches sur l’histoire de la clinique médicale, c’est cette intuition qu’une vérité se dit dans la souffrance du patient, que l’être se dévoile derrière le corps meurtri. Nous ne pensons pas qu’il existe un logos de la maladie ; autrement dit une vérité scientifique de la personne malade, un langage de la physiopathologie qui ne demanderait qu’à être analysé pour être compris. Il s’agit au contraire d’une des facettes de la complexité de l’être humain. La clinique invite le médecin à se pencher au lit du patient pour y percevoir une vérité d’ordre anthropologique. Par ses difficultés, par ses dysfonctions corporelles parfois peu ragoûtantes, le malade laisse percevoir ce qu’il est intégralement, non pas une personne malade mais une personne en attente de retrouver ses pleines potentialités.
Foucault rappelle avec justesse l’importance de la notion d’opacité dans le développement de la clinique et de l’anatomo-pathologie. L’opacité du corps humain a guidé le clinicien dans le développement d’outils de plus en plus perfectionnés, pour forcer l’indirectement visible à se dévoiler. Cette apparente impénétrabilité du corps interroge l’esprit cartésien, le pousse dans ses retranchements. La technique et l’imagerie médicale sont venues au secours du clinicien dans sa soif de compréhension de l’humain malade. A cette notion d’opacité du corps humain il nous semble important d’ajouter celle de profondeur. Les techniques d’imageries les plus perfectionnées permettent de représenter l’être humain avec précision. Elles auraient pourtant tendance à nous faire oublier une dernière dimension constitutive de l’être : la profondeur. Ce que la technique ignore, la synthèse perceptive peut nous l’apporter : ce ventre que je palpe m’échappe autant qu’il se livre, car mes mains cherchent à percer sa profondeur. Conscient de cette dualité, le médecin donne à partir des données scientifiques l’épaisseur et la largeur mais c’est bien sa propre perception qui lui rend la profondeur. Reconnaître cette profondeur comme une dimension qui nous échappe, c’est faire acte d’humilité. Le diagnostic ne peut pas tout dire, le médecin ne peut pas tout soigner. L’être humain est un seuil de mystère, une vérité qui n’est jamais complètement acquise.
Le diagnostic est une notion instrumentale, un terme technique et scientifique qui recèle une promesse de guérison. Interface entre un médecin et son malade, il est un objet dont chacun peut se saisir pour exprimer à l’autre sa perception d’une situation communément vécue. Il se situe au cœur de ce noyau éthique¸ relation entre un malade et son médecin où se prennent des décisions qui ont parfois de lourdes conséquences. Ainsi, le diagnostic est à l’interface entre la plainte et sa remédiation, porteur d’une dimension intrinsèquement éthique. Loin d’une innocence nominaliste il est déjà une thérapeutique en puissance. Cette interface cristallise les questions de vérité, c’est-à-dire d’adéquation au réel, et de légitimité. Elle entraîne toutes les questions éthiques soulevées par l’action humaine. C’est justement cette profondeur perceptive, anthropologique et éthique qui fait du diagnostic un lieu exceptionnel. Cette activité diagnostique est fondamentalement une activité humaine, dont la profondeur est à la mesure de ce qu’elle souhaite comprendre : l’être humain. Le colloque singulier est donc loin de s’affranchir de sa dimension prioritairement humaine.
Bibliographie :
[1]. Théodule M.-L., « L’intelligence artificielle, as du diagnostic médical » in Le Monde, Paris, 3 octobre 2018. ; Cimino V. ; « L’IA peut réaliser un diagnostic médical avec plus de précision qu’un humain », in siecledigital.fr, [consulté le 21/06/20].
2. Éthique de la recherche en apprentissage machine, CERNA, Paris, Juin 2017, p. 30.
3. Shortliffe E. et coll., « An artificial intelligence program to advise physicians regarding antimicrobial therapy », in Computers and Biomedical Research, an International Journal, 1973, pp. 544-560.
4. Quaglini S. et coll., « ANEMIA: an expert consultation system », in Computers and Biomedical Research, an International Journal, 1986, pp. 13-27 ; Potter B. et coll., « Computerized dermatopathologic diagnosis », in Journal of the American Academy of Dermatology, 1987, pp. 119-131.
5. Achi H. et coll., « Automated Diagnosis of Lymphoma with Digital Pathology Images Using Deep Learning », in Annals of Clinical and Laboratory Science, 2019, pp. 153-160.
Tschandl P. et coll., « Comparison of the accuracy of human readers versus machine-learning algorithms for pigmented skin lesion classification », in The Lancet oncology, 2019, pp. 938-947.
Vujosevic S. et coll., « Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges », in The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2019, pp. 337-347.
6. Littré É., Dictionnaire de la Langue française, Paris, Hachette, 1863, t.4, p. 1889.
7. Foucault M., Naissance de la clinique, Paris, PUF, collection Quadrige, [1963] 2017, p. 130.
8. Idem, p. 133.
9. Ibidem, p. 136.
10. Ibid., p. 185.
11. Ibid., p. 155.
12. Bertaud-Gounot V. et coll., « Ontology and medical diagnosis », in Informatics for Health and Social Care, 2012, pp. 51-61.
Shen Y. et coll., « An ontology-driven clinical decision support system (IDDAP) for infectious disease diagnosis and antibiotic prescription » in Artificial Intelligence in Medicine, 2018, pp. 20-32.
13. Ibidem, p. 164.
15. Idem, p. 503.
16. Ibidem, p. 509.
17. Ibid., p. 509.
18. Aristote, Éthique à Nicomaque, 1112 b 13-16, Paris, Flammarion, 2004, trad. Richard Bodéüs, p. 146.
19. Ricoeur P. , « Les trois niveaux du jugement médical », in Esprit, n°227, décembre 1996, p. 21.
20. Idem, p. 21.