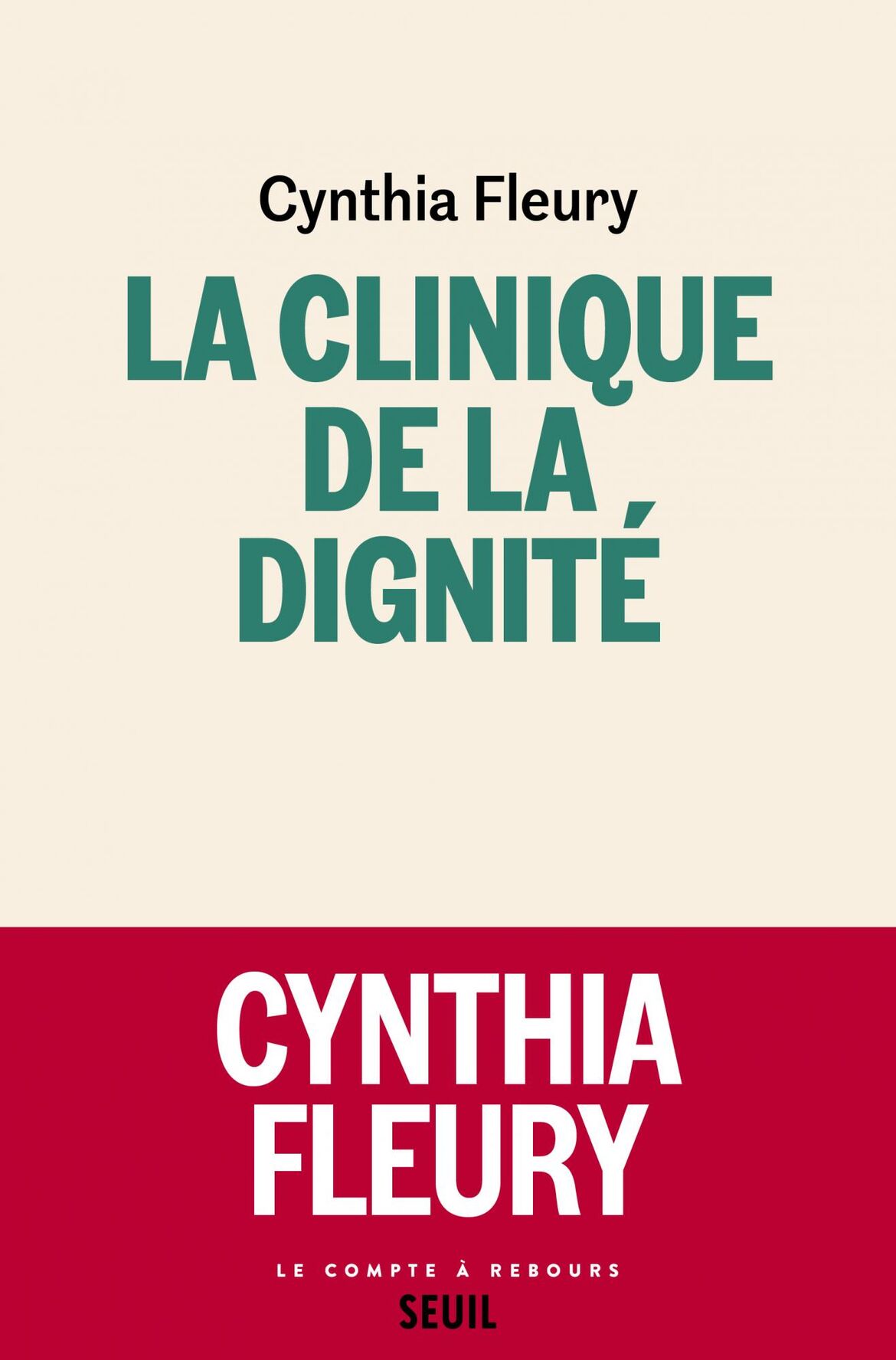A propos de La clinique de la dignité, Paris, Éd. du Seuil, 2023.
Par Bertrand QUENTIN
MCF HDR Université Gustave Eiffel
Article référencé comme suit :
Quentin, B. (2023) « Auscultation de l’indigne avec Cynthia Fleury : diagnostics et propositions » in Ethique. La vie en question, octobre 2023.
NB : Le texte est accessible en version PDF au bas du document.
La collection « Le Compte à rebours » dirigée par Nicolas Delalande et Pierre Rosanvallon a pour particularité de présenter le texte d’un invité ou d’une invitée suivi de textes plus courts d’autres intervenants et intervenantes intitulés « Rebonds et explorations ». L’ouvrage qui nous intéresse ici est celui de Cynthia Fleury intitulé La clinique de la dignité, publié en 2023 et suivi de trois rebonds : « La dignité au regard des droits » par Claire Hédon, « Inhumaine dignité. La charge de la Terre et des vivants » par Benoît Berthelier et « De l’humiliation à la résistance. La mobilisation des malades du SIDA » par Catherine Tourette-Turgis.
Le texte de Cynthia Fleury fait 120 pages. Plutôt qu’un travail parfaitement nouveau et original il faut le considérer davantage comme un jalon, comme un travail de synthèse et de prolongement des analyses que l’autrice a menées ces dernières années. Sera donc ici auscultée la « dignité ». Depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ce concept est devenu un concept de droit positif. Mais l’on peut ajouter que « la notion de dignité s’est imposée ces dernières décennies comme aussi centrale que celles de liberté et d’égalité » (9). Plus encore, si nous suivons la philosophie d’un Axel Honneth, en plaçant au cœur du social le concept de « reconnaissance », une nouvelle hiérarchie des principes démocratiques semble se dégager, posant le concept de dignité devant celui d’égalité, « comme si l’ultime atteinte à la dignité était plus déterminante encore que celle à l’égalité » (24). Cependant une tendance inverse apparaît également, réinterrogeant la légitimité du concept de dignité : « comment définir la dignité humaine dans un contexte qui dévalue la notion d’universel, ou qui ne reconnaît pas l’exceptionnalité humaine par rapport au reste du vivant ? Comment croire à la validité de ce concept tandis que la modernité reste une fabrique collective de l’indignité des vies » (19).
L’indigne partout
L’ouvrage ne nous parle pas d’un monde de guimauve, mais bien du nôtre, celui pour lequel trois chapitres ont pour titres respectifs : « l’indignité universelle », « la clinique du « sale » » et « le devenir-indigne du monde ». Cynthia Fleury ne mâche pas ses mots : avec elle « nous pénétrons dans le monde de l’indécence commune (common un-decency) » (78). Et alors que par le passé, seuls des groupes ciblés d’individus étaient violemment concernés par le risque de perte matérielle de dignité, la modernité semble devenir « une fabrique systémique de perte de dignité pour le sujet. Avec la réalité anthropocénique, les vécus d’effondrement se multiplient, comme les risques de déplacement des populations » (75-76).
Bien-sûr le discours ambiant maintient encore les apparences au sein des démocraties occidentales : Il y a « d’un côté le discours toujours plus solennel de valorisation de la dignité humaine et universelle ». Mais, « de l’autre la multiplication des formes dégradées de dignité dans les institutions et les pratiques sociales (hôpitaux, Ehpad, prisons, centres de réfugiés ou de migrants, pauvreté et précarisation des vies ordinaires, etc.) Le devenir indigne de la société s’est banalisé, donnant à voir un retour de l’incurie dans le quotidien de nos vies, et ce plus spécifiquement dans le monde du soin » (10). Nous avions utilisé il y a quelques années l’expression d’« homme des marges ». Cynthia Fleury procèdera ici à « une analyse du concept de dignité par ses marges et son envers, en proposant une « clinique de l’indignité » » (10).
Il ressort des analyses de la philosophe la responsabilité centrale des institutions dans la dégradation généralisée du sentiment de dignité des individus : « La souffrance éthique advient quand la confiance dans l’institution disparaît progressivement, voire totalement […] Le devenir-indigne de l’institution s’est considérablement généralisé, non seulement par le biais de la banalisation des « modes dégradés » comme nouveaux modes de gouvernance et d’urgence, mais également par l’acceptation de l’abandon de valeurs relevant de l’empathie la plus élémentaire […] Il faut entendre le discours des personnels soignants, des universitaires, des directeurs d’école et de lycée, des agents de l’aide sociale à l’enfance, ou encore des magistrats, des policiers, etc.» (83-84). Ce qui tend dorénavant à manquer c’est la « capacité « phorique » de l’institution [comme] condition sine qua non de l’efficience d’un soin » (84).
Plus généralement, c’est la totalité du monde du travail qui est atteinte. On retrouve ici une reprise des analyses de Christophe Dejours à propos de la souffrance au travail et des épuisements professionnels devant un qualitatif dévoyé par un recours sournois au quantitatif. « Les atteintes à la dignité des personnes sont devenues un mode de management commun dans la société, tant en son centre (le monde « inclusif » du travail) qu’à ses marges (le monde de l’exclusion sociale) » (11). « notre modernité accumule les mécanismes de production de l’indigne ordinaire, dans les institutions de toutes sortes (administrative, scolaire, culturelle, policière, etc.), dans le monde du travail, dans l’espace public, etc. » (41).
Dans ce monde hostile, rien ne nous sauve : Même le care a sa face d’ombre. La « clinique du sale » (Chapitre 3) va nous le mettre sous les yeux. « nulle notion n’échappe à son instrumentalisation, ni à son ambivalence substantielle : le care, le « prendre soin », n’y échappe pas non plus. Derrière son évidente bienveillance, il engage des rapports de force sombres, voire inavouables » (43) Ce n’est pas ici le « vernis communicationnel » qui est en jeu, mais bien la structuration interne du concept : « le care déporte sur « autrui » une charge qu’il dit pourtant assumer » (43). L’éthique du care emporte donc avec elle sa falsification possible, à savoir le « dark care », le « dirty care », en français « le sale boulot ».
Cynthia Fleury marche sur les pas de Joan Tronto, Pascale Molinier, Everett Hughes, pour lesquels « soigner se résume encore trop souvent à assumer le « sale boulot »» (46). Pourtant « Ce dirty work n’est nullement indigne, mais chacun s’en éloigne pour le faire porter par d’autres, comme s’il était indigne de lui » (46). Elsa Dorlin nous montrera de même que pour que les uns reçoivent le soin, il faudra que d’autres endurent une violence dans leur corps. Pour restituer leur dignité à certains (nos aînés dépendants), d’autres vont se trouver dans des conditions indignes (tous ceux qui s’occupent de nos aînés dépendants). Et assumer le sale boulot fait de vous instantanément un « invisible ».
Cette ambiguïté du care se trouvait déjà à la source du discours colonialiste et Joan Tronto en était consciente. Le legs de la civilisation comme « fardeau de l’homme blanc ». « Ce « prendre soin », non consenti, [qui] a créé des dettes infinies pour les populations autochtones » (43). La face sombre du care en fait « une technique de soumission de l’autre sujet dit vulnérable, qui dévitaliserait sa puissance de résistance en la délégitimant, puisqu’il s’agit d’une aide et non d’une oppression » (44-45).
La clinique de l’indignité commencera alors par une « éthique narrative de l’indignité » « « Ecrire la vie indigne » est essentiel pour formaliser une pensée de la dignité, à l’instar des éthiques narratives qui sont désormais indispensables à la constitution des sujets humains » (28). Un moment particulièrement réussi de l’ouvrage est cette mise en avant du débat entre Margaret Mead et James Baldwin au début des années 70 où l’on assiste en direct à un « dialogue de sourds terrible » (34) entre les deux penseurs. « Alors que Baldwin réhabilite l’universel en témoignant d’une conception de la dignité humaine apte à supporter l’adversité de l’exil, réel et symbolique, Mead ne saisit pas la portée conceptuelle d’un tel acte » (37). « Mead n’entend pas ce que Baldwin dit de la condition humaine, et pas seulement de la condition noire, comme elle ne parvient pas vraiment à penser l’effet structurel de sa couleur de peau : « le fait d’être blanche ne m’a jamais ni meurtrie ni particulièrement avantagée » » Ce qui amène Fleury à conclure « Jusqu’à ce jour encore, quantité d’individus sont « dominants » par défaut, pendant que d’autres sont « dominés » par défaut » (36). Poursuivant avec Baldwin le ton est véhément : « la réconciliation est impossible avec « ceux » qui sont désignés comme meurtriers, murderers […] qui cherchent délibérément à conserver l’ordre dominant qui « perpétue » les régimes d’indignité infligés aux « autres » […] notion qui fait écho à l’impardonnable de Jankélévitch » (39). Il faudra donc se mettre au clair sur les effets systémiques du colonialisme : « Toute clinique de la dignité se pose […] nécessairement comme dire vrai sur le fait du meurtre » (39). Mais Cynthia Fleury n’est pas héraut d’une violence répondant à la violence : « L’enjeu, si ardu soit-il, est d’articuler jusqu’à la tension maximale les approches décoloniales et la possibilité d’un universel, sans essentialiser ni les notions d’irréconciliation ni celles de réconciliation » (40). Il faudra en tout cas garder la leçon de Baldwin à Mead : sont victimes de l’indignité même ceux qui n’en ont pas conscience (Mead en l’occurrence). « La clinique de l’indignité montre […] que les victimes de l’indignité sont universelles, car personne n’échappe à l’amplitude de l’indignité » (40). Même les nantis de la célébrité commencent à pouvoir craindre le lynchage médiatique qui essore la dignité de celui qui se croyait préservé. Nathalie Heinich avait repéré que le « capital de visibilité » définissait désormais les nouvelles élites sociales (Heinich : 2012). Pour l’avoir peut-être expérimenté elle-même, Cynthia Fleury mesure le nouveau risque que courent les personnalités médiatiquement mises en avant : « C’est le retour de la fama communis ou publica comme outil de régulation sociale et morale par les communautés, ou plus spécifiquement de la di-fama, autrement dit du risque – de plus en plus probable – d’une atteinte à la réputation par des campagnes communicationnelles d’une rare violence et efficacité […] La dégradation par la parole est devenue un risque très probable, non seulement pour les plus « connus », mais aussi pour les citoyens ordinaires, sur lesquels elle agit comme un vieil outil de « régulation », c’est-à-dire de contrôle » (106).
Nous pourrions alors espérer des gouvernements démocratiques une réponse à la hauteur de tous ces enjeux : Malheureusement cette réponse est plus qu’inquiétante : « le gouvernement a tendance, en régime d’exception, à quitter l’approche aristotélicienne et jurisprudentielle de l’éthique, centrée sur le respect et le soin de la personne en tant que telle, pour une éthique de type utilitariste, dédiée au management et à la sécurité du grand nombre, quitte à mettre à mal les identités et les modes de vies des singularités » (78). Dans ce « devenir indigne du monde » où la crise climatique s’accroît, le nombre des dé-placés progresse considérablement et c’est le camp qui devient un lieu de plus en plus commun et qui risque encore de progresser quantitativement avec les conditions de l’anthropocène : « Les camps ne sont […] pas des lieux garants de l’hospitalité, mais précisément les témoins des limites de l’hospitalité d’une société […] il ratifie le fait que la société a considéré certaines vies comme indignes » (89).
Que faudrait-il faire ? En particulier « la « politique de la dignité […] est prioritairement une affaire d’éducation et de soin […] la politique actuelle entérine – de façon indigne – un sous-investissement dans ces domaines » (121). « Les sociétés produisent généralement, par défaut d’éducation et d’entraînement, des normes morales assez basses, qui ont tendance, dans une situation de survie imposée à la collectivité, à s’effacer complètement » (58).
La question qui nous est posée est dorénavant : « comment protéger une conception de la dignité à l’âge de l’anthropocène ? » (85)
L’inquiétant dans tout cela, c’est que les populations des pays démocratiques aisés n’ont pas envie de prendre acte des faits déplaisants. Comme le dit Everett C. Hughes : « Il est bien connu que les gens peuvent garder le silence et le font à propos de choses dont la discussion ouverte menacerait la conception que le groupe a de lui-même et donc sa solidarité […] briser le silence, c’est attaquer le groupe, une sorte de trahison si c’est un membre du groupe qui le fait » (Hughes, 1962 : 26). C’est ce silence partagé qui permet à nos fictions de groupe de s’épanouir : nous allons maintenir notre confort, continuer à rouler en voitures individuelles, aller au ski et prendre l’avion pour passer des vacances au soleil. Dans les livres d’histoire l’épuration ethnique est le mal absolu (Hitler est une contre-figure consensuelle pour tous) mais quand nous avons besoin de gaz à bon prix pour l’hiver, nous sommes prêts à accepter que l’Azerbaïdjan d’Aliyev entre septembre et octobre 2023 procède à l’épuration ethnique d’une population arménienne ancestrale et surajoute à cela un discours négationniste affirmant une vie ancestrale azérie que les historiens savent ne jamais avoir existé. Une épuration ethnique dans le présent est toujours plus abstraite qu’une épuration ethnique élevée au rang d’historique. Et la lâcheté d’un pétainisme du présent est souvent invisible tant qu’elle n’a pas atteint les manuels d’histoire.
Le réel va pourtant nous revenir à la figure : « La prise en considération des déboires anthropocéniques que la Terre subit nous oblige à reconfigurer nos circuits de production et de consommation, à penser des économies circulaires et de recyclage, à produire de l’habitabilité de ce monde sans simultanément produire de l’inhabitable à ses environs » (60). Une nouvelle forme d’invalidation est en route : « face à une société qui fabrique de l’indignité […] La société s’invalide en tant que telle » (24). Et pourtant se maintient le narratif mondial de l’ultraconsommation comme preuve du bonheur et de la dignité. « les responsables politiques, quand ce ne sont pas les individus eux-mêmes, considèrent ces modes d’être et de consommer comme « non négociables » » (92). Nous trouvons alors ici malgré tout une goutte pour notre soif, avec Jared Diamond, lorsqu’au sein de ses douze propositions pour enclencher une renaissance en contexte d’effondrement apparaît la formule suivante : « développer une tolérance collective et individuelle à la frustration »…
La clinique face à l’indigne
Cynthia Fleury prend alors son bâton de pèlerin et nous trace un chemin de propositions : « l’éthique du care peut sortir du piège de l’indignation […] La philosophie du « soin », souvent taxée de sentimentalisme et d’un rapport à la réalité trop peu pragmatique, défend à l’inverse le parti pris de l’agir indissociable de la production de relations dignes interpersonnelles » (108). S’indigner ne sera pas une solution suffisante : « L’indignation rend logiquement impossible la négociation, et notamment la négociation politique. Il n’est donc nullement aisé d’utiliser – au sens politique du terme – l’indignation sans mettre à mal et la qualité d’authenticité de ce sentiment, et la qualité de pertinence d’une décision politique. » (99) Et elle conclut d’une jolie formule : « L’indignation est un fusil à un coup ». La technique d’indignation, en court-circuitant les voies classiques de la représentation et de la décision politique, lui substituerait un régime émotionnel sans limites – ce qui mettrait en danger la société tout entière (on se souvient du régime émotionnel de la Terreur).
La résolution des conflits de reconnaissance par le saupoudrage matériel ne sera pas une solution : « le sujet qui a oublié la règle originelle de la sublimation de la finitude croit qu’il faut se remplir, de manière compulsive et boulimique, pour rassurer l’immense angoisse de vivre et la crainte, dans la rivalité mimétique, d’apparaître moins bien loti que son voisin » (91).
Il ne faudra pas non plus répondre à la violence par la violence « un sujet sain, ne résiste pas longtemps à la violence permanente, et sans autre but qu’elle-même. A terme, celle-ci se retourne également contre lui en l’intoxiquant. Le premier pas d’une clinique et d’une politique de la dignité se définit par la sublimation de la violence » (71). « La sublimation reste l’ultime rempart, politique, contre la domination. Elle préserve un îlot, certes intérieur, mais irréductible, résistant à la colonisation de l’être, comme l’a décrit si parfaitement Frantz Fanon. Pour autant, il ne suffit pas de reconnaître la vertu de la sublimation pour s’en satisfaire comme seule activité politique » (33).
D’autres propositions sont donc là : « convoquer les outils des humanités médicales (éthique narrative, approche capacitaire de la vulnérabilité, savoir expérientiel, etc.) nous permet d’élaborer une clinique de la dignité précisément apte à déjouer demain les nouveaux pièges de la réification et de la stigmatisation du vulnérable, en le faisant basculer du côté du capacitaire, du juste diagnostic, de l’innovation conceptuelle et expérientielle » » (Note 10 p.32). « il n’y aura « dignité » que parce qu’il y a cocréation de celle-ci, autrement dit, participation active, agente, desdits sujets […] le « patient » n’est aucunement passif. Il est coréalisateur de sa guérison, de son rétablissement comme de sa dignité » (49). » (49).
Pour empêcher que le travail du care ne s’inverse en « sale boulot » il faudra « renforcer le caractère humain de ces tâches (l’attention), en valorisant davantage la relation au sujet, par la conversation, le temps pris pour accomplir ces tâches, et surtout le temps « autre », pour développer avec le sujet une relation qualitative venant valoriser ce qui reste capacitaire chez ledit sujet » (55). Anne Marché-Paillé proposera « une clinique de la conversation, c’est-à-dire de l’adresse soutenue, d’une éthique du lien social » (55). Le « portage » est là : s’aider à se co-porter. Ici nous ne pouvons pas ne pas penser à cette analyse d’Anne Grinfeld qui d’une critique éthique de la formule « on va se laver » prononcée régulièrement par les aides-soignantes vis-à-vis des personnes âgées en vient à finalement reconnaître le caractère judicieux de cette formule. « Parfois il est plus facile d’aborder une personne en faisant un pas de côté, ce que permet le « on » […] éviter la violence qu’il y aurait là à nommer le besoin de toilette chez […] un adulte […] le « on » permet effectivement d’adoucir cette situation » (Grinfeld, 2023 : 220) et plus loin : « Le patient ayant des troubles cognitifs est un patient qui est souvent aux prises avec l’angoisse […] le parler quotidien que nous retrouvons dans la phrase on va se laver permet de tenir à distance, de part et d’autre, cette angoisse que la soignante intuitionne » (idem : 223). C’est ce type de « portage » (le « coping » des anglo-saxons) qui est également en jeu dans l’ouvrage de Cynthia Fleury et qui peut faire du care autre chose qu’un « dirty care ». « Transformer ce dirty care en care est un des grands enjeux de la clinique de la dignité » (56).
Même si elle se méfie d’une valorisation romantique de la pauvreté il ne faut pas pour autant passer à côté de situations de créativité riches : « L’indignité, l’hypervulnérabilité du traumatisme, ne sont pas uniquement des situations malheureuses […] ce sont de facto, des milieux d’hypercontrainte, donc des lieux génératifs de conception et d’usages nouveaux, comme de production d’aptitudes et de compétences nouvelles. Ces cliniques du vulnérable sont pourvoyeuses d’apprentissage et de méthodes de conception, comme d’expérimentations de protocoles inédits » (Note 10 p.32). C’était déjà le message qui transparaissait dans Ce qui ne peut être volé (Charte du Verstohlen) petite plaquette co-écrite avec Antoine Fenoglio (que nous oserons placer dans la continuité du Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain de Simone Weil). « Il est impératif que les architectes se saisissent de l’obligation de concevoir ces lieux, qu’ils ne les abandonnent pas à leur destin d’inhabitabilité et d’indignité […] construire ne sera pas nécessairement l’unique geste architectural, qu’il va falloir prioritairement réhabiliter, « dénormaliser », entretenir, prendre soin, réparer, se lier intelligemment au vivant dans son ensemble » (87).
Nous retrouvons ensuite une proposition qui était déjà centrale dans Les irremplaçables (2015) : la revendication d’un retour aux « communs ». « La notion de commons (communs) partage avec celle de la dignité son caractère inaliénable, inappropriable, qui ne peut être réduit à une simple marchandise, ou à toute autre forme de réification. Il est donc logique que les communs représentent l’un des outils les plus efficients pour mettre en place une « politique de la dignité » » (113). Mais il faut insister avec Pierre Dardot et Christian Laval sur le fait que « le commun est à penser comme co-activité, et non comme co-appartenance, co-propriété ou co-possession » (Dardot/Laval : 2014, 43). Le terme doit désigner non seulement ce qui est mis en commun, mais aussi et surtout ceux qui ont des responsabilités et des charges en commun.
Il reste une difficulté institutionnelle pour faire passer la logique des communs auprès de nos gouvernants : « les communs font basculer les modes de gouvernance du côté des systèmes complexes, très décentralisés et articulés aux milieux endogènes […] ce n’est pas là la culture de la gestion technocratique » (115).
Cynthia Fleury va finir par nommer les héros de la croisade nouvelle contre le devenir-indigne du monde – ceux qui vont pouvoir épauler les soignants : « la fonction clinique doit être […] portée par un ensemble d’acteurs […] assumant une mission explicite de résistance au « devenir-indigne » du monde […] les associations de la société civile […] les hautes autorités indépendantes […] Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté […] les universitaires et les sociétés savantes, les entreprises à « raison d’être », les sociétés « à mission », la sphère des médias et des réseaux sociaux […] cette constellation est garante d’une approche holistique, de proximité, respectant la singularité des parcours et des individus » (126). Le propos n’est-il pas un peu optimiste quand on pense à ce que la sphère des médias et des réseaux sociaux peut aussi produire ?
La pratique comme psychanalyste de Cynthia Fleury l’a cependant rompue à ne pas se satisfaire de beaux principes philosophiques bienveillants et généraux. Elle le sait : il y aurait de la vanité dans tout cet écrit s’il n’y avait pas un peu de résultat clinique tangible : apporter un mieux à quelqu’un. Les patients qu’elle reçoit à son cabinet (une analyste n’utiliserait pas ce vocabulaire) sont certainement des garde-fous pour elle, afin de ne pas céder démagogiquement au seul appui d’un discours revendicatif : « indignez-vous ! et obtenez de l’Etat, du système ce à quoi vous avez droit ». Cela mènerait vite au ressentiment (on retrouve son précédent ouvrage Ci-gît l’amer). Revendiquer une reconnaissance de la dignité par le biais systématique d’une compensation monétaire sera une impasse : « Vouloir « vérifier » intégralement l’ordre du qualitatif exclusivement par celui du quantitatif voue le sujet à la passion-pulsion de l’insatiabilité : cette « liberté » relève en fait de l’addiction et de la dépendance, au sens où le sujet croit pouvoir combler le manque uniquement par la matérialisation […]. Or la matérialisation seule ne comble rien, car le manque est structurellement infini. Seul le symbolique est susceptible de calmer le rapport à l’absence, qui reste inéluctable » (22). Le problème de la revendication actuelle de la dignité est qu’à ne pas vouloir de principes et de symboles et à exiger de « « vérifier » par le quantitatif ses appétences qualitatives, [cela] piège finalement le sujet en lui offrant comme seul horizon la frustration et le ressentiment » (21). « Quand les conditions matérielles de dignité sont absentes, l’individu ne perd nullement sa dignité, symbolique. Certes, il est impératif de ne pas s’en contenter, et de chercher toujours à obtenir les conditions réelles, matérielles, de la vie digne ; mais cette réalité symbolique, principielle, de la dignité en tant que telle de l’individu, reste néanmoins une valeur extrêmement protectrice des processus de subjectivation et de constitution des personnes » (103).
Cynthia Fleury pose des questions dérangeantes : on comprend vite que la matérialisation concrète d’un respect de la dignité se maintient dans nos pays développés par un ensemble de facteurs qui ne sont pas durables : « certes, la dignité est un inaliénable symbolique, un principe intangible, mais la grande conquête de la modernité a été d’envisager sa matérialisation, autrement dit sa reconnaissance comme droit positif. Or celles-ci n’existeraient pas sans les régimes énergétiques qui sont les nôtres et qui font reposer le destin de nos démocraties sur les ressources fossiles. Savons-nous seulement demeurer dans des Etats de droit en dehors de nos systèmes carbonés, en dehors de la croissance économique fondée sur l’extraction des fossiles ? » (77).
C'est un privilège de blanc occidental que de penser que le cas particulier vécu par un groupe ethnique particulier n'est qu'un cas particulier. C'est souvent quand le cas particulier touche des blancs occidentaux qu'il mérite alors d'atteindre le qualificatif d'universel. C’est en cela que pour l’autrice l’expression de « dignité noire » ne s’assimilerait aucunement à la seule « dignité des Noirs ». L’adjectif « noir » s’universaliserait « pour évoquer les faces sombres et honteuses de l’Histoire » (30). On pourra cependant être réservé devant cet emploi très américain de la couleur de peau comme référentiel universel. On regrettera ainsi parfois dans l’ouvrage de Cynthia Fleury une trop grande porosité à la mode anglo-américaine. La main d’œuvre ouvrière en France au XXe siècle a d’abord été essentiellement italienne, espagnole, portugaise avant de devenir maghrébine dans les années 50-70. Parler alors « du cas exemplaire de la condition noire ouvrière » (80) nous semble, pour la France métropolitaine, un peu « hors sol » d'un point de vue sociologique. Trop parler de « décolonialisme », d’« intersectionnalité », ne fait-il pas également courir le risque d’importer en France certains conflits qui lui seraient surtout fantasmés. ? On rappelle que Baldwin, que cite beaucoup l’autrice, est un écrivain afro-américain, né à Harlem en 1924 et mort en France en 1987 - la France qu’il disait avoir choisie car elle le reposait des tensions raciales et homophobes qu’il vivait aux Etats-Unis. Cela ne nous dédouane pas de nous regarder aujourd’hui dans un miroir critique et à toujours œuvrer pour vivre mieux ensemble. Mais l’intersectionnalité a parfois tendance à s’oublier dans le discours revendicatif. L’autrice nous dit que « l’opinion publique juge désormais la perspective d’une moralité impartiale impossible sans que soient mis à nu ses fondements coloniaux […] l’approche décoloniale apparaît ainsi essentielle pour accéder à ce qui pourrait être une dynamique universaliste robuste épistémologiquement et moralement parlant » (20-21). Il reste à savoir si l’opinion publique doit être le baromètre absolu d’une pensée exigeante. Si l’objectif politique et individuel peut être l’émancipation, il doit s’agir d’une émancipation « par le haut », par la confrontation à ce que la culture a de riche et non à obtenir des places enviées en présentant des brevets de souffrance. Rappelons ce truisme qu’il ne suffit pas d’être pauvre pour être honnête. A nouveau le beau travail précédent de Cynthia Fleury dans Ci-git l’amer doit nous éviter une politique d’exacerbation de l’amertume en rappelant qu’être un humain restera toujours une conquête difficile et pour laquelle personne n’a de passe-droit. N’y a-t-il pas parfois ici une certaine démagogie idéaliste de l’inventivité du pauvre et de cette « éthique narrative de l’indignité » qui va faire advenir « la nouvelle ère, celle de l’émancipation pour tous » (31) ? Mais pour pasticher Alain, nous préférerons toujours un optimisme de volonté à un pessimisme d’humeur…
On appréciera en tout cas, comme à chacun des ouvrages de Cynthia Fleury, une certaine droiture de style et une pratique en tant qu’analyste qui la sauve de trop grandes généralités philosophiques. Au total nous avons là une synthèse claire, riche, scrupuleuse, vivifiante à propos des problématiques brûlantes qui continuent à faire du concept de dignité une boussole pour notre temps. Sans omettre les risques de dévoiement mortifère qui mettent en cause notre hypocrisie, notre paresse et notre déni. A nous de jouer maintenant.
Références
Dardot P. et Laval C. Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La découverte, 2014.
Grinfeld, A, « « On va se laver », ou de l’usage éthique du pronom « impersonnel » On dans les soins » in Controverses éthiques d’aujourd’hui, dir. B. Quentin, Paris, Éd du Cerf, 2023, pp.211-224.
Heinich N., De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Gallimard, 2012.
Hughes, E. C., « Good People and Dirty Work » in Social Problems, vol. 10, N°1, 1962, pp.3-11 ; « Les honnêtes gens et le sale boulot » in Travailler, vol 24/2, p.26.