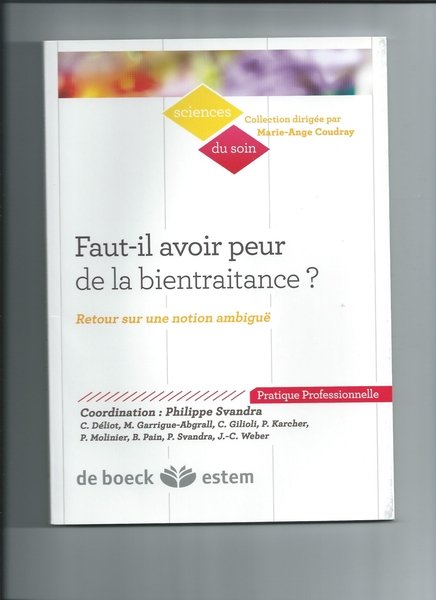"À huit contre la bientraitance"
Bertrand QUENTIN
Critique de l’ouvrage Faut-il avoir peur de la bientraitance ?, coordonné par Ph.Svandra, Paris, De Boeck-Estem, 2013.
Une chose semble certaine : le concept de "bientraitance" ne ressortira pas vivant de la lecture de ce livre, si tant est qu’il soit encore pris au sérieux par les véritables soignants…
Nous n’assistons pas ici à une séance des Sept Samouraïs mais à huit auteurs qui se succèdent pour dégommer ce concept à tour de rôle. Nous pouvons cependant rassurer le lecteur : il n’y a en cela aucun effet de lassitude, car chaque auteur y va de sa voix propre et ce sont à chaque fois des perspectives différentes qui s’ouvrent. On peut donc féliciter Philippe Svandra d’avoir coordonné cet ouvrage en s’étant entouré de gâchettes qui se complètent avec des nuances variées. Svandra est passé par l’Ecole éthique de la Salpêtrière et en est un digne représentant : la langue de bois est laissée au vestiaire et il y a toujours un effort authentique pour penser.
C’est Marie-Garrigue Abgrall, elle aussi passée par notre école, qui ouvre les "hostilités" avec le chapitre : "La bientraitance, du concept à la pratique". Elle rappelle utilement que ce concept est apparu dans le contexte de la petite enfance – domaine qu’elle connaît bien puisqu’elle est éducatrice de jeunes enfants depuis 1984 et auteure de l’ouvrage Violences en petite enfance chez érès. Le concept était cependant écrit avec un tiret ("bien-traitance"). La "bientraitance" a aujourd’hui gagné le domaine de la gériatrie, mais Abgrall s’en tient à ce qui est son domaine. L’apparition de ce néologisme pouvait être un appel à contrebalancer les mauvais traitements à l’égard des enfants. Les mauvais traitements les plus profonds pouvaient ne pas être physiques mais être de l’ordre de ce qu’Alice Miller, psychanalyste, appelle la "pédagogie noire" (Miller, 2002). Abgrall explicite ce mode de la pédagogie noire "qui dès l’âge du nourrisson, s’efforce par tous les moyens (punitions, humiliations, privations, contraintes, mais aussi manipulations douces, tromperies au nom de la vertu, répétition de tâches destinées à prouver l’obéissance, etc.) d’étouffer les sentiments (manifester de la joie quand on ressent de la colère), les affects, les pulsions de vie, pour prôner l’obéissance et la piété au dépend de toute liberté intérieure et de l’authenticité du ressenti de chacun, au nom du bien. L’enfant se construit alors en "faux self", source de risques pour sa propre personnalité fragilisée et/ou pour son entourage" (13). Il reste à savoir d’où vient cette maltraitance qu’elle appelle aussi "négligence" - terme cher à Eric Fiat. De manière platonicienne, Abgrall voit le mal dans l’ignorance : "c’est l’ignorance qui reste la première cause de la plupart des carences éducatives et de leurs conséquences" (14). Cette ignorance n’est pas que d’ordre cognitif : "nous avons aussi des mécanismes de défense qui nous empêchent de les percevoir, ce sont les mécanismes d’évitement, d’aveuglement, de déni, etc. Et on a beau vouloir être bientraitant, ces mécanismes agissent aussi en nous. Il y a également l’empathie dangereuse, celle qui conduit à vouloir supprimer le bébé qui crie, les malades, les handicapés, les vieillards pour supprimer l’émotion, la maladie, le handicap, la vieillesse" (14). Mais en pastichant Winnicott, Abgrall revendique un soignant qui ne soit que "suffisamment bon", un soignant qui ne s’épuise pas à vouloir être comme la mère qui veut être parfaite avec son enfant. Le concept de "bientraitance" n’est pas satisfaisant : "c’est un mot trop fermé sur lui-même, comme si désormais nous savions tout du "bien traiter"" (8). La vérité c’est que "les soignants de tous bords qui pratiquent le soin au sens large et des soins thérapeutiques font tout ce qu’ils peuvent, en toute conscience professionnelle, pour bien soigner et pour bien traiter ceux dont ils s’occupent" (8). Par l’introduction du terme de "bientraitance" c’est une suspicion remettant en question les pratiques quotidiennes qui a alors été durablement installée. On ne devrait d’ailleurs pas se focaliser autant sur l’aspect purement individuel d’un soignant face à sa "maltraitance" : "Il y a des contextes d’accueil insuffisants, tels que l’absence de personnel, l’absence de formation, l’absence de moyens adaptés, qui peuvent générer les conditions d’apparition de négligences plus ou moins graves" (14). Comme Aristote ne cesse de le montrer dans l’Ethique à Nicomaque, il y a bien une responsabilité collective à rendre possible une atmosphère où l’on pourra se comporter d’une manière pleinement humaine.
Jean-Christophe Weber, chef de service de médecine interne à Strasbourg, dans le second chapitre ("Douleur, éthique et "bientraitance"") s’attaque plus précisément à la terminologie employée. "Bientraitance" serait un nouvel avatar de la "bienveillance" (qui depuis le XIIe siècle allie le bien et le vouloir) ou de la "bienfaisance" (qui n’apparaît qu’en 1725 dans le sens de la charité chrétienne). Serait-ce une laïcisation de termes connotés de façon trop religieuse ? Il reste que dans "bientraitance" au "bien", c’est le suffixe "traiter" qui est maintenant associé. "Un soin, c’est déjà en quelque sorte une "bientraitance", ce terme est redondant, il n’ajoute pas grand-chose. Au contraire, peut-être même opère-t-il une soustraction. En effet, dans le champ de la santé, traiter c’est agir sur l’homme, et ce qui disparaît dans la bientraitance est la distinction, qui n’est pas sans conséquences, entre traiter la maladie et soigner le malade" (24). La dégradation d’une certaine qualité de relation humaine est en marche : "le droit à la bientraitance, tel qu’il est maintenant opposé à la "maltraitance ordinaire" est, en son essence, la revendication d’être traité…comme un objet, même si c’est un objet d’attention ou de soins. Seuls des objets en effet sont traités. Maltraitance et bientraitance font la paire et se chauffent du même bois ! […] Quant au soignant, il sera désormais prié de se comporter comme une machine traitante" (29). L’objectif qui se cache derrière tout cela est avant tout financier : "il s’agit d’autre part […] de limiter autant que possible le nombre de professionnels qualifiés, et d’y embaucher des agents aussi peu formés à l’accompagnement des personnes vulnérables et au soin que possible, sans risquer trop de dérapages médiatiquement ruineux. L’enjeu est le suivant : quelles consignes procédurales faut-il imposer pour pouvoir "lancer" un novice peu qualifié, voire même en situation de précarité psychosociale, dans des zones de haute turbulence souffrante, par ailleurs contraint au rendement ?" (25). Une "machine traitante" coûtera moins cher qu’un soignant qui pense chacun de ses actes en faisant attention au patient spécifique dont il s’occupe. Ce qui est en route, c’est aussi une démarche permanente et anxiogène d’évaluation prônée par l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médicosociaux) avec des objectifs réels, qui ne sont pas ceux affichés : "S’il s’agissait de bienfaisance ou de bienveillance, il ne viendrait à l’idée de personne d’en planifier le développement ! La lecture du plan [Weber évoque ici le plan de l’ANESM] nous convainc toutefois que la bientraitance (21 occurrences dans le texte) est un habillage qui masque mal l’objectif prioritaire qui est la lutte contre la maltraitance (76 occurrences). Il est question d’évaluation (21), de contrôle (18), de signalement/signaler (19), de procédure (7). Ce sont donc encore des mesures de police, au service d’une lutte contre un mal désigné" (25).
Pascale Molinier intervient alors avec un troisième chapitre intitulé "Pourquoi le care n’est-il pas bientraitant ?". Chapitre que l’on peut particulièrement saluer comme étant d’un haut niveau d’intelligence et qui "fait mouche" à chaque phrase. Ecoutons Molinier : "La bientraitance, je dirai que c’est le travail prescrit, et le care, c’est le travail réel. Jamais fait là où l’on croit et par qui on croit. C’est pour cela que le care n’est pas bientraitant […] Je ne crois pas personnellement, que d’être passé de la maltraitance à la bientraitance représente un progrès décisif, encore moins un changement de paradigme […] La bientraitance demeure, à mes yeux, un paradigme condescendant. Ce n’est pas du vocabulaire qu’on utilise pour qualifier les pratiques des médecins. On ne dit pas d’un chirurgien qui reconnaît lui-même avoir des difficultés pour communiquer avec ses patients qu’il est maltraitant, et pourtant son désintérêt pour la vie et les souffrances psychiques des personnes qu’il opère peut être vécu comme une violence par certaines d’entre elles. On ne l’enverra pas non plus se "former en relation"" (35). La "bientraitance" est une injonction à l’égard du personnel placé au plus bas de la hiérarchie et donc la prescription a quelque chose d’insultant : "Se soucier des autres, pour un humain, c’est "la moindre des choses". Ce n’est pas une "bonne pratique". Je veux dire par là que cela n’a pas à être prescrit car le care est beaucoup affaire de circonstances" (34). La description par Molinier de ce que l’on voit dans les établissements accueillant des personnes âgées et la façon dont on peut l’interpréter de l’extérieur est d’ailleurs édifiante : "Le matin, les soignantes distribuent les médicaments, donnent les petits déjeuners, font les toilettes, les lits, déplacent le linge sale, etc. Le travail est physique et doit être réalisé dans un temps contraint, on ne va pas laisser les gens au lit toute la journée […] En début d’après-midi, c’est plus calme, les soignantes essaient de récupérer tout en surveillant d’un œil les personnes âgées. D’une manière générale, la charge physique est sous-évaluée dans les maisons de retraite. On s’attend implicitement à ce que les soignantes puissent faire huit heures de travail de force, ce qui n’est pas possible, et l’effort assez violent et soutenu et réalisé le matin n’est généralement pas compensé par la pause, quand elle est prise […] Plus la couleur de peau des soignantes est foncée, plus les représentations sociales des Noires (forcément ?) costaudes risquent de faire leur œuvre en sourdine. […] Dans l’esprit des gens qui les surprennent assises, elles ne sont pas en train de récupérer, elles "glandent". Autre stéréotype sous-jacent : les Noires sont nonchalantes (et les Arabes désobéissantes). Dans cette semi-vacuité qui suit le repas, les personnes âgées, fatiguées elles aussi, ont tendance à glisser fâcheusement dans leur fauteuil. Oui, mais si on les redresse, elles reprendront inexorablement la même posture dans le quart d’heure qui suit. Alors les soignantes laissent couler et n’agissent qu’en cas de risque d’une franche et imminente dégringolade. Ce laisser-aller n’est pas du goût d’autres personnes qui, elles, sont dans le moment le plus intense de leur activité, comme l’animatrice et les bénévoles" (37). La "maltraitance" c’est donc aussi une affaire d’interprétation, une idéologie qui suresponsabilise les familles et les rend méfiantes et agressives. La "bientraitance" n’étant pas un concept clair, il y a là un kaléidoscope d’interprétations : " Ce qui est non bientraitant ne fait pas l’objet d’un consensus immédiat entre les différentes personnes qui se préoccupent d’un malade. La définition de ce qui, est bon pour lui est plutôt l’objet d’un rapport de force constant entre les différents protagonistes, d’autant que le patient ne peut pas toujours donner son point de vue ou qu’il est lui aussi disqualifié […] Aussi longtemps que ces points de vue sont institués comme hiérarchisés, en l’occurrence le point de vue de l’animatrice ou celui des familles vaut plus que celui des soignantes et celui des patients, on ne peut pas savoir si l’intérêt qui l’emporte est vraiment celui du patient" (39). Pascale Molinier montre alors que les soignantes ont une autre expérience que celle des familles. Elles ne savent rien de ce qu’était la personne auparavant, mais elles ont des connaissances sur la maladie et sur la personne devenue malade. "C’est une chance pour les patients que certaines personnes ne les jugent pas à l’aune des ce qu’ils étaient avant. C’est une chance que ces personnels aient été éduqués et s’éduquent entre eux à rechercher le consentement des patients. Les dépendances sont telles que les choix sont restreints, mais au moins ont-ils la possibilité de manger le petit-suisse convoité ce jour-là plutôt que la compote qu’ils aimaient "avant" et qu’ils doivent désormais ingurgiter quotidiennement" (39). Pour sortir par le haut de ces difficultés il faut rétablir un climat plus serein et c’est peut-être cela le secret d’une bientraitance qui ne serait pas creuse : "Cela veut dire une éducation des familles à faire confiance, laquelle implique que l’encadrement fasse confiance à son personnel" (40). Au passage, Molinier écorne ce qui a été un lieu commun du travail social : le professionnel devrait garder une "distance professionnelle", ne pas avoir de relation affective au patient. "on dit souvent aux soignantes les moins qualifiées à la fois qu’il ne leur faut pas "s’attacher" (aux patients, aux enfants, aux vieillards, etc.) et qu’il leur faut être bientraitants […] Cette double injonction est paradoxale ou absurde : comment être bientraitant sans s’attacher ?" (32). "la prescription si courante de "ne pas s’attacher" s’avère la plus contre-productive et la plus absurde en termes de care. On peut montrer que le modèle le plus fiable pour traiter convenablement les personnes consiste à les traiter précisément comme si elles étaient des proches : "je la soigne comme ma propre mère"" (40).
Patrick Karcher dans le chapitre qui suit, "Bientraitance en EHPAD : l’histoire d’un malentendu", rappelle également que la plus grande partie des plaintes de patients concerne le non-respect d’une certaine normalité des relations. A l’inverse "Les gestes de la vie ordinaire sont également mobilisés en faveur de la bientraitance. C’est ici la conception d’une relation ordinaire qui se construit sur de petites choses (le fait de dire bonjour, de frapper avant d’entrer) qui est valorisée. Les soignants rappellent leurs difficultés à maintenir des espaces de vie ordinaire au sein d’établissements soumis à une médicalisation croissante" (46). Il y a eu une "dénaturalisation" de la relation de soin. "La relation au soigné n’apparaît plus naturelle, inhérente à la fonction du soignant […]. La montée de "l’imprévisibilité de droit de la réaction et de l’orientation individuelle" qui accompagne la montée de l’individualisme et du pluralisme des valeurs, fait que la relation de soin est déstabilisée ; il n’y a plus de conduite "juste" mais une relation à construire en fonction des valeurs de chacun" (45). Une directrice témoigne ainsi : "on s’est détaché du bon sens ces dernières années à vouloir tout sécuriser et tout protocoliser" (45). Cette "dénaturalisation" de la relation de soin est issue de "qualiticiens [qui] se sont appropriés la bientraitance avec la volonté de traduire le concept en indicateur" (49). On a abouti à la déstabilisation de soignant ne pouvant se reporter aux seuls savoirs acquis et à une intériorisation de la responsabilité qui signifie aussi une intériorisation de la culpabilité. Officiellement on évalue le fonctionnement d’une institution à travers les éléments structurels de la prise en charge du résident (mise en place de formations, de conseils de vie sociale, de comités d’éthique, intégration du thème de bientraitance dans le projet d’établissement, etc.) et des éléments de la qualité de la démarche évaluative (réponses aux questionnaires d’autoévaluation, existence d’un plan d’amélioration, etc.). Mais à partir du moment où on met en avant le terme de "bientraitance", on sous-entend une propriété liée à une pratique ou à une personne et on tombe alors dans le jugement moral de cette pratique, ou de cette personne.
Catherine Déliot dans le cinquième chapitre nous parle de "Bientraitance, puissance idéologique du discours" et selon une inspiration foucaldienne s’attaque aux sous-entendus inaperçus du langage. Elle est sensible au fait que les soignants acceptent paradoxalement le terme de "maltraitance" mais se hérissent devant celui de "bientraitance". Ce dernier terme en effet revient à un déni de reconnaissance des savoir-faire soignants dans leur dimension éthique. Un soignant témoigne : "C’est comme s’il y avait trois niveaux de soin : un soin maltraitant, un soin neutre, un soin bientraitant" et Déliot de questionner : "Peut-il y avoir du soin sans bienveillance ? Peut-on appeler soin l’exécution simple d’un acte technique, la réalisation d’une tâche ?" (56). En creusant un peu plus l’analyse, Déliot en vient à avancer que le discours de la bientraitance relèverait d’une incapacité à penser la violence féminine : "Les termes de bientraitance et de maltraitance […] constitueraient une terminologie éthique spécifique au domaine du travail féminin" (61). A cela s’ajoute le "formatage de la culture soignante par les cultures juridiques des associations d’usagers et les cultures ingénieuriques des services qualité. Un processus d’ "occupation", de "domination" et de "colonisation" de la culture soignante par ces deux cultures" (62). Déliot termine alors par une revendication de la parole des soignants : "les soignants doivent se donner le droit et le pouvoir d’avoir voix au chapitre, de donner de la voix, d’articuler dans leur propre langage leur conception du soin, d’exposer leur éthique du soin d’une voix puissante et d’imposer leur propre discours" (64).
Le titre du chapitre de Philippe Svandra "Le soin n’est pas soluble dans la bientraitance" reprend une formule dont Dominique Folscheid était friand. Svandra établit une série claire de mises au point : "Il nous faut alors réaffirmer cette évidence : le soin ne peut être que bientraitant (sinon il perd immédiatement sa raison d’être)" (75). On comprend donc pourquoi ce terme est étranger au vocabulaire traditionnel des soignants. Svandra récuse la symétrie entre "maltraitance" et "bientraitance" : "si les deux termes sont […] opposés, ils ne sont […] pas pour autant symétriques, tout simplement parce que si le mal est assez facilement objectivable et peut faire consensus, il n’en est pas de même du bien qui relève d’un jugement hautement subjectif" (70-71). "s’il existe un terme opposable à celui de "prendre soin", ce ne serait pas "maltraitance", mais plutôt "négligence"" (75). "Le soin revient donc à nous lier les uns aux autres, à avoir du souci pour autrui et par conséquent le traiter avec sollicitude" (75). Svandra retrouve ici le beau mot choisi par Ricoeur et qui a plus d’épaisseur que la "bientraitance".
Dans le septième chapitre, Christian Gilioli, passé également par l’Ecole éthique de la Salpêtrière, s’intéresse à un aspect tout à fait différent au sein du thème de la bientraitance. Il traque les zones où les protocoles de la bientraitance sont invisibles ou oubliés. Nous sommes devant la fameuse tâche aveugle : c’est le personnel soignant lui-même qui peut être l’exclu le plus manifeste des protocolisations de bientraitance des directions de la Qualité. "les cadres soignants […] se trouvent sommés d’augmenter la qualité du service rendu (allonger les temps de consultation, individualiser les soins, etc.) tout en conservant des agents dont tout le monde connaît la faiblesse professionnelle" (78). "étrange ambiance où il faut traquer les niches de productivité tout en gardant (officiellement) le souci de la bientraitance comme horizon […] Certains agents pris dans cette tension dialectique connaissent alors une sorte de nomadisme professionnel interne, passant d’un poste à l’autre sans véritable préparation ou sans posséder les qualités intrinsèques aux postes proposés […] Rompant avec ce qui semblait être une sorte de mission tacite de la fonction publique, les agents non performants, ou plutôt hypoperformants, sont vécus de plus en plus […] comme les parias d’un monde résolument tourné vers l’efficience" (78). Nous avions vu une injonction paradoxale avec l’aide-soignante qui devait être bientraitante et ne pas s’attacher aux patients. Nouvelle injonction paradoxale ici : être bientraitant avec son personnel et obtenir des gains de performance dans les équipes : "le malaise gestionnaire des cadres paraît légitime tant la situation de double bind qu’ils connaissent alors – accueillir un agent non performant qui va, mécaniquement faire baisser l’efficience du service pendant que l’équipe de direction maintient l’exigence de performance – ne leur laisse par définition aucune porte de sortie. Le recours au saupoudrage est d’autant plus fréquent que l’on assiste toujours, dans le cadre de la recherche de productivité, à la disparition progressive mais continue de ce que l’on pouvait appeler des niches d’emplois protégés comme les buanderies, les salles de garde, etc." (80). Le constat peut donc être amer pour Gilioli : "le recul d’une sorte de compassion humaniste […] au profit de ce que l’on peut convenir de nommer le soin réduit à une prestation (dans une logique de plus en plus contractuelle) tend aussi à professionnaliser, au sens de la compétence technique des personnels qui vivaient autrement la noblesse de leur métier" (80).
Le dernier chapitre est écrit par Benoît Pain et s’intitule "Bienveillance et sympathie. Les incertitudes de la bientraitance". Il est très riche en termes de matériaux mais, malheureusement, de composition beaucoup trop anarchique. Une première partie navigue autour des thématiques de la bientraitance à l’hôpital avec comme point focal la personne Eugène B, souffrant de maladie d’Alzheimer. Il est dommage que le propos manque un peu de lecture critique. Pain affirme par exemple : "La bientraitance telle qu’elle est ici définie apparaît comme une démarche ouverte, totalement en cohérence et en harmonie avec l’ensemble des approches contemporaines soignantes" (90). Il faudra attendre une dizaine de pages avant que soit entrevue l’esquisse d’une distance par rapport aux "éléments de langage" des directions de la Qualité : "Ceux qui présentent la bientraitance comme un principe éthique et politique identifié n’ont qu’exceptionnellement souci de développer chez les professionnels et les usagers une culture du soin, l’instrumentalisant dans tout autre but que le bien-être des patients" (99). La seconde partie de l’article est très hétérogène par rapport à la première. Elle est également fort riche en matériaux visant à clarifier le terme de "bientraitance" au sein des termes "bienveillance" et "sympathie" mais flirte souvent avec les digressions hors sujet. Benoît Pain semble vouloir donner ses lettres de noblesse au concept de "bientraitance" mais en l’analysant de manière parfaitement anachronique, comme si ce terme avait été employé par Hume, Smith ou Scheler. (ex : "la bientraitance, entendue à la façon humienne" (110) ou "la bientraitance est beaucoup moins réactive que ne le croit Scheler" (111)). On flotte donc sans cesse entre des termes approchants. Il aurait peut-être mieux valu assumer que "bientraitance" est un néologisme purement contemporain et se demander pourquoi jusque-là on employait d’autres mots "à sa place" et se demander enfin s’il apporte quelque chose de conceptuellement justifié plutôt que de justifier à toute force ce que des bureaux de la Qualité ont inventé. Il reste que le lecteur trouvera quantités de références riches et utiles à la pensée, dans ce travail de Pain.
Philippe Svandra remarquait : "comment être contre la bientraitance ! […] En relevant d’une forme de rhétorique de l’évidence qui fait florès aujourd’hui, la bientraitance semble ne donner prise à aucune critique". Bravo à lui et à son équipe de fines gâchettes qui ont pourtant réussi à monter le contraire. Nous ne pouvons qu’inciter le lecteur à se procurer et à lire cet excellent réactif contre la langue de bois de notre temps. Nous l’avons dit en introduction : après ce parcours, le concept de bientraitance "ne bouge plus beaucoup". Jean Christophe Weber dit sans ambages : "la bientraitance n’apporte aucune nouveauté pour penser le soin" (30). Nous avons peut-être, comme le disait Claude Quentin (qui n’a aucun lien de famille avec votre serviteur…) "laissé entrer dans la bergerie un loup déguisé en mouton, sans trop prêter attention au fait qu’il bêlait de façon bizarre" (Quentin C., 2009).
Références bibliographiques :
Aristote (2004). Ethique à Nicomaque, trad. Bodéüs, Paris, GF Flammarion.
Miller A (2002). C’est pour ton bien, racines de la violence dans l’éducation de l’enfant, Paris, Aubier.
Quentin C (2009). Conférence du 17 novembre 2009 pour les trente ans de l’IFCS d’Angers.
Svandra et al. (2013). Faut-il avoir peur de la bientraitance ?, Paris, De Boeck-Estem.